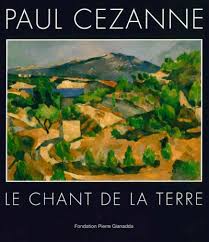Que dios nos perdone, Roberto Sorogoyen, Espagne, 2h05.

Noir & chaud
Merci les conseils du Masque et la plume ! L’été 2017 est résolument noir et chaud.
Hot hot hot, « some like it hot » comme une climatisation de voiture en panne en plein cagnard ou Madrid en été 2011, personnage principal du film, plus réussi que Paris dans La bataille de Solferino (Justine Triet, 2013), entre les Indignados manifestant à la centrale et symbolique Puerta del Sol suite à la crise économique et à l’impuissance des politiques conservateurs corrompus (la hiérarchie, incompétente, préfère étouffer l’affaire pour des raisons d’image et de catholicisme ; les flics virés sont réengagés au noir tant les collègues sont nullissimes ; une réunion management fait froid dans le dos sans parler de la non prise en compte du handicap), et la venue du pape hispanisant Benoît XVI (finalement habemus papam au 2e tour suite à démission !) lors des journées mondiales de la Jeunesse (JMJ). Le metteur en scène précise : « L’été 2011, avec son atmosphère chaotique, extrêmement tendue, était très intéressante d’un point de vue dramaturgique : pas facile de mener une enquête au milieu de milliers de manifestants. Il était intéressant aussi de situer cette histoire dans le centre ancien de Madrid, un quartier où vivent de nombreuses personnes âgées qui sont des proies faciles pour le personnage du tueur. » Le film commence par une scène en plongée le petit matin où les employés municipaux de Madrid nettoient à grands jets d’eau le lieu d’une de ces manifestations, en référence au nettoyage à grande eau de la place après l’évacuation musclée des indignés avant l’arrivée du pape et de la foule des pèlerins. Amis touristes, savourons ces habitations sordides à lumière jaunasse où des familles entières vivent entassées pour 300 € par mois dans des caves sans aucune ouverture extérieure, le propriétaire, un péquin moyen tentant lui aussi de survivre, ne voyant pas où est le problème. Sorogoyen avoue : « Au départ, je voulais que certains plans représentent des tableaux de Goya ».
Noir car la ressortie de Memories of murder (Bong Joon-ho, 2003 ; Sorogoyen avoue : « Un autre film déterminant a été le coréen Memories of Murder, particulièrement pour sa capacité à donner de la chair aux personnages – ce qui manque souvent dans les films hollywoodiens. Comme Bong Joon-ho, nous avons décidé de montrer souvent les personnages en train de manger, de boire, ce qui leur donne beaucoup d’humanité. ») remémore un couple de flics dont un violent ; le toujours coréen jouissif Sans pitié (Bulhandang, Sung-hyun Byun, 2017), entre Scorsese et Tarantino.
Passée la vague ibérique des films d’horreurs cultes (Amenabar, Balagueró, Álex de la Iglesia dont l’excellent Balada triste de trompeta, 2010, où joua déjà Antonio de la Torre), voici un tsunami de polars réalistes sur fond historique (Alejandro Amenabar, La isla minima, Alberto Rodriguez, 2014 où de la Torre jouait un père de famille bourru, incapable de communiquer avec ses deux filles adolescentes ; Enrique Urbizu ; le glaçant Niña de fuego, Carlos Vermut, 2015 ; La colère d’un homme patient, Raúl Arévalo, 2016, Goya du Meilleur film, où le même de la Torre était un vengeur froid, méthodique et taciturne ; Daniel Monzon).
Néo-polar
Le schéma classique du polar est respecté : couple de flics aux personnalités opposées, originalité du serial killer apparaissant à la 90e minute, amoureux des chats comme le célibataire commissaire Bourvil dans Le cercle rouge (Melville, 1970), inquiétant au visage d’ange, jeune et émacié n’ayant pas résolu son Œdipe auprès d’une mère, auquel il est dévoué, dominatrice et castratrice (« À chaque fois qu’on parle d’un psychopathe qui l’est en raison d’un traumatisme lié à ses relations à sa mère, on pense à Psychose. Il y a toujours des références conscientes et inconscientes, mais j’ai tout fait pour ne pas copier » précise Sorogoyen), de Javier Pereira, jouant un charmeur dans le deuxième film de Sorogoyen, Stockholm (2013), triangle de violences interrogeant la virilité masculine, rivalités avec la hiérarchie policière, dans le commissariat, catholicisme interrogé dans sa rigidité.
L’originalité se fonde sur l’ambiguïté des personnages. Le binôme de policiers est impayable. Mieux que dans L 627 (B. Tavernier, 1992), l’ambiance du commissariat est brossée de façon contrastée avec les conflits internes. De la Torre a travaillé son rôle avec des policiers, déjà interrogés pour préparer Groupe d’élite (Unit 7, Grupo 7, Alberto Rodríguez, 2012), une autre histoire d’agents aux méthodes douteuses. « Au début de Que dios nos perdone, quand je réalise l’inspection oculaire de la vieille dame assassinée et que j’éteins la lumière, mon contact m’a dit exactement comment procéder. » Se mettre à la place des personnes âgées souillées par un gérontophile, bien membré mesdames, est une idée incroyable. Quant au défaut d’élocution, l’acteur, tel un introverti à la Keyser Söze à la mine de Dustin Hoffman, l’a travaillé avec une association de bègues, benêt Bayrou, si tu nous lis ! Il joue un célibataire, très solitaire, renfermé qui voit le mal partout. Avec ses intuitions, les collègues le surnomment le « Génie ». Velarde, avec son unique costume étriqué, écoute un disque vinyle de fado d’Amália Rodrigues (« Que deus me perdoe », tiens, tiens !) tout en observant par le judas la gardienne, qu’il harcèle, nettoyant le palier.
Le bodybuildé Alfaro, incarné par Roberto Alamo, déjà présent dans La piel que habito, Almodóvar, 2011 d’après le roman de Thierry Jonquet, auréolé ici du Goya du Meilleur acteur, cohabite avec sa fille adolescente, insupportable, sort promener son chien. Le flic à l’ancienne, ami des putes, est fébrile, inquiet et révolté. Sa femme le trompe comme toutes femmes de flics qui se respectent dans les films. Alfaro est sanguin, susceptible, se bagarre avec ses collègues mais se révèle réactif et volontaire, un peu trop, peut-être. Il est sanctionné par le Conseil de discipline pour coups et blessures infligés à un collègue qu’« il ne peut pas sentir ». Une pièce pour un distributeur de café, lieu de sociabilité au travail, cause des embrouilles. Les emmerdes arrivent en escadrille. Viré, il se saoule, se ramasse quelques cocards, essaye d’enterrer son chien dans le jardin de son immeuble. Les résolutions des histoires intimes et parallèles est un peu trop simple à mon goût. Une scène de blague qui tombe à plat à côté d’un bar à tapas est inutile pour un film un tantinet trop long.
Fils de douanier, ex journaliste, de la Torre, jouissant d’ubiquité tel l’argentin Ricardo Darín succédant à l’espagnol Javier Bardem en haut de l’affiche, inspiré du jeu d’Alfredo Landa, résume : « Je crois que les grands personnages sont polysémiques. En gagnant en maturité, j’ai appris à fuir le manichéisme. Dans ce film, les deux policiers ne sont peut-être pas très différents du criminel qu’ils poursuivent. »
Structure
Le metteur en scène, qui a co-écrit le scénario, d’après des faits réels, avec Isabel Peña, décrypte son film : « La première partie montre en quelque sorte la routine des policiers, dans leur travail comme dans leur vie privée. Certes, on voit des cadavres, mais il y a aussi quelques moments comiques. J’ai eu envie de filmer cela de manière « documentaire », caméra à l’épaule. La deuxième partie est beaucoup plus sombre : j’ai pensé qu’une mise en scène davantage « fiction », plus stylisées, plus sophistiquée, exprimerait mieux cette dimension plus obscure, plus violente. C’est un paradoxe intéressant : plus on s’enfonce dans le chaos des personnages, plus la mise en scène est posée ». Caméra nerveuse sur scénario tendu avec dialogue au cordeau (humour –noir ; pas de fuck mais beaucoup de « corones »), mise en scène et montage efficaces, musique flippante quasi indus du français Olivier Arson, abus de plans-séquences et grands angles, une scène de poursuite à pied à la Se7en (1995) et Zodiac (2007) de David Fincher dans la foule madrilène chauffée à blanc. « Au niveau visuel, nous nous sommes inspirés aussi de La French, le thriller du Français Cédric Jimenez consacré au trafic de drogue à Marseille dans les années 70 ». Enfin, un curieux épilogue pluvieux rendant jaloux le gouvernement qui taxe l’énergie solaire.
Prix du Meilleur scénario au dernier Festival de San Sebastian ; prix Sang neuf au Festival international du film policier de Beaune 2017, ville où s’est récemment implanté, je vous la sors Beaune, hum Lelouche, le tâcheron du cinéma français mais ne tirons pas sur l’ambulance. Pas mal pour un 3e film, non ? La monstration de corps nus de personnes âgées, tant cachés, se généralise avec l’augmentation de l’espérance de vie en occident et la pyramide démographique : Quelques heures de printemps (Stéphane Brizé, 2012), Amour (Haneke, 2012), etc.
Reste à regretter cette riquiqui salle 6, même rénovée, au Comœdia. A noter une critique indigente du Monde, journal malheureusement en perpétuelle décadence, qui se permet en outre un jugement moral sidérant au XXIe siècle (« film aussi nauséabond qu’ennuyeux »).