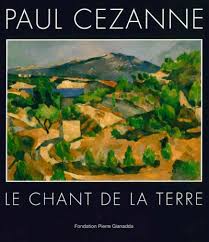Introït
Une exposition remarquable, venue du Victoria and Albert Museum (V&A ; commissaires : Victoria Broackes et Geoffrey Marsh, directeur du département « Spectacle vivant » ; mise en scène : agence Clémence Farrell ; éclairages : Atelier Audibert) à Londres et adaptée à la sauce française (là-bas : plus mode et design ; ici : plus musical ; 100 mètres de moins ; plus de recul pour apprécier les visuels, ambiances moins confinées mais parcours plus labyrinthique ; salle finale moins impressionnante que l’effet cathédrale au V&A ; sous-titrage des vidéos, traduction de tous les textes ; coin rajouté sur le rapport entre Bowie et la France), dans un nouveau lieu, un étron comprimé, imitation Frank O. Gehry, entre deux blocs de béton avec fonte d’alu en jeux de lumière, La Philarmonie de Paris, flanquée d’une étrange attèle rouge. Les travaux continuent. L’entrée avec ses pics au plafond laisse songer en des temps pompidoliens éloignés et démodés. A l’instar de Nouvel, je me suis demandé également si un procès pouvait être diligenté concernant la signalétique indigente où il est de bon ton de ne pas indiquer où est la billetterie, agrémentée d’un panneau « guichet fermé », quoiqu’ouverte, alors que nous tentions de prendre un billet. Des filles avec un anneau dans le nez, des filles qui ressemblent à des garçons et réciproquement, des acteurs-trices, des fans de la première heure et les générations suivantes, des John Do pas Jones, etc. Présent dans les starting-blocks le dernier jeudi à 11h, 15 mn de queue. Le catalogue de l’expo, traduit par Jérôme Soligny, écrivain, musicien, compositeur pour Etienne Daho et journaliste havrais, est déjà épuisé. Autre indice : le millionième visiteur a été repéré le 5 mai à Paris. L’heureux fan, un instituteur niortais, reçoit en cadeau le catalogue d’exposition dédicacé The man who sold the world par David Bowie en personne. En dernière ligne droite, les horaires étendus à minuit.
Pourquoi ce succès ? Si le risque est l’iconisation (nombreuses citations ; mouchoir en papier portant la marque du rouge à lèvres de la star sauvé de la tournée Diamond Dogs en 1974 ; la fiche anthropométrique, face et profil, du matricule 59.640, prise par la police de Rochester (USA), le 25 mars 1976, date à laquelle Bowie fût arrêté pour détention de cannabis puis rapidement libéré ; le trousseau à clefs de David & Iggy à Berlin en 1977 au 155, Hauptstrasse ; une cuillère à coke ; un croquis sur un paquet de Gitane éventré, etc.), trait de notre époque, David Bowie est, comme Hitch, « la toile blanche sur laquelle nous dessinons nos rêves » selon le sociologue britannique Simon Frith. Le caméléon parle à tout le monde grâce à la culture pop et à l’interdisciplinarité, faisant feu de tout bois en captant ses diverses époques. Une des rares personnes à faire bouger les lignes, comme il est dit aujourd’hui, en surfant sur de véritables transgressions, pas celles serinées actuellement aux Beaux-arts.
Bowie is. This is it (M. Jackson): les identités. It = ileli, bien avant la théorie des genres (cf. Oscar Wilde, Jean Genet que Bowie a rencontré et fêté dans The Jean Genie d’Aladdin Sane, Devine chez Waters, etc.). Coup de tonnerre : silhouette élégante, David Bowie, affirme en 1972 sa bisexualité au magazine Melody Maker. 3e sexe : la (post-) modernité est décidément androgyne. L’intitulé concernant l’expo Hugo à la BNF pourrait être également appliqué : « L’homme-océan ». Ou alors The world of David Bowie comme le titre de sa première compilation, en mars 1970 chez Decca.
Un nouveau concept d’expo déjà entrevu à Starwars identities ; mais ici, c’est plus grand et nettement moins cher. La thématique n’est pas éloignée. Bowie a exploré avec une hyperactivité créative, jusque dans ses excès, les recoins de ses diverses identités (homme/femme/3e sexe/extraterrestre ; les avatars : Ziggy Stardust, Aladdin Sane, Halloween Jack, The Thin White Duke, Nathan Adler). Un système de casques est distribué. La société allemande Sennheiser a mis au point le système : « Chaque boîtier contient un identificateur qui reconnaît les ondes transmises dans les différentes salles, explique Robert Généreux, directeur commercial de la marque. Quand vous bougez, le signal s’éteint, et le suivant se déclenche. » L’avantage est le côté immersif. L’inconvénient est de tomber sur des autistes qui gueulent leurs impressions, voire chantent faux, vous percutent car absorbés par l’audio au point de devenir aveugle. En outre, entre le son de la salle et celui du casque, qu’il est possible toutefois d’enlever, le tout peut se révéler cacophonique en simultané. D’autre part, l’ajout proliférant d’adjectifs ou noms en rouge n’ajoute absolument rien, voire brouille le message.
A l’entrée, nous tombons nez-à-nez avec une performance drolatique du couple mythique Gilbert & Georges avec english humour : le thème de l’identité est posé, l’anglais avec son excentricité, la question de la sexualité. Le costume taillé par Yamamoto (Kansai pas Yoji), une combi Tokyo Pop (1973), inspiré du théâtre Kabuki, qui ressemble tant à un disque vinyle qu’à un clown blanc à rayures, sert d’enseigne de l’expo, outre l’éclair d’Aladdin Sain de Brian Duffy, de la même fournée – qui n’a d’ailleurs jamais été porté en tournée. Ce sera notre oncle Ronald pour celui qui est coté en bourse ! Pour situer à quel niveau de maigreur le workaholic se trouvait alors : il n’a pas été possible de faire rentrer « la brindille », Kate Moss, lors d’une récente séance de photo, dans le costume d’Aladdin Sane ! Bowie avait découvert le travail du nippon lors du défilé londonien du créateur en 1971, très théâtral et remarqué. Il s’agissait au départ d’une création pour femme. Mais « Bowie ne laisse jamais les idées des autres ni les normes sociales interférer avec ce qu’il veut faire », souligne Victoria Broackes. « Bowie représente une idée de liberté : être qui l’on veut, s’habiller en homme ou en femme, être homosexuel ou hétérosexuel, c’est un message extrêmement important et libérateur ».
So young
La première pièce cause jeunesse dans le contexte historique et social de l’Angleterre de l’après-guerre avec la grisaille de l’époque et ses maisons détruites avec tickets de rationnement : la pupille gauche dilatée (les yeux ne sont donc pas vairons, voyons !) à cause du coup de poing de son copain George Underwood à l’âge de quinze ans, le passage du quartier défavorisé de Brixton à l’upper class, le déménagement du jeune photogénique à la branchée Soho en faisant le tapin (The London Boys, une chanson sur la drogue, l’aliénation, la compétition), devenir connu pour ambition, il pastiche l’acteur et chanteur maniéré Anthony Newley, il traîne dans divers petits groupes (une publicité en 1966 pour l’un de ses premiers groupes, Kon-rads avec sa tenue « mod » avec cravate et costume de velours en gardant une coiffure années 1950 ; le show théâtral de Riot Squad avec maquillage à la Arthur Brown dont il fit souvent la première partie ; jouer du sax, bottes hautes et chemises froufroutantes, cheveux longs et vestes de tweed, lorgnant côté Pretty Things ou Downliners Sect avec la morgue rhythm’n’blues en sus dans King Bees ; Manish Boys ; Liza Jane, qui ne devait plus rien au gospel qui l’a inspiré, digne des Kinks au sein d’un groupe nommé Lower Third, chanson reprise aux USA pendant la tournée Reality sur le riff détourné de Smoke on the water de Deep Purple, etc.) dont il maîtrise l’image (croquis de tenue de scène d’un groupe du début, Delta Demons : dessins de costumes, des esquisses de décors), l’apprentissage du mime et du théâtre avec Lindsay Kemp, avec qui il couche tout en mettant les bouts avec sa maquilleuse et sa costumière Natasha, rencontré grâce à Twink, le batteur fou des Pretty Things, la revendication de pouvoir porter des cheveux longs (à la tv à 17 ans, cravate op art et coiffure à la Marriott, pour défendre la Société contre la cruauté envers les chevelus ; cf. plus tard La coupe à 10 francs, Philippe Condroyer, 1975). Tout y est : do 7e majeur, suspendus, descentes de basse chromatique et inversions, le modal siphonnés des Beatles ; mélodies fortes sur des harmonies outrées ; la spécificité bowienne est le travail fin des transitions, des ponts, le travail de la voix de tête et, avec l’âge et la clope, de la voix de poitrine en modulant sur une longue colonne d’air.
Contexte familial : ses tantes Una, Vivienne et Nora ont subi des internements, des électrochocs et des lobotomies ; sa mère, Peggy, ouvreuse de cinéma, avouait volontiers être « folle ». ; le père, un héritier, dilapide le patrimoine d’une fabrique familiale de chaussures du Yorkshire en se rêvant patron de night-club. Le demi-Frère ? Terry Burns, le bien nommé, de dix ans son aîné, étiqueté schizophrène, s’échappe d’un institut psychiatrique du Surrey pour finir, en 1985, par aller s’allonger sur des rails de chemin de fer. Jump, they say (Black tie White noise », Savage, mai 1993, LP produit par Bowie et Nile Rodgers ; un disque que ma mère m’avait offert en référence à mon cousin, qui lui-même sera tardivement diagnostiqué schizophrène, amateur de Bowie). L’évocation était déjà présente dans All the Madmen (The man who sold the world, 1971). L’influence de Terry a été déterminante. Il fut le premier héros du jeune Bowie. Musicalement, il a fait découvrir à 13 ans les clubs de jazz et de rock londoniens, l’énergie du live. En littérature, il l’a introduit aux poètes de la beat generation, ces Allen Ginsberg et William Burroughs, que Bowie côtoiera plus tard. Mentalement, il l’a initié à l’instabilité psychique. « C’est un homme venu de nulle part, appelé David Jones, probablement le nom le plus commun que vous pourriez avoir en Angleterre, qui est devenu une superstar. Ses hauts et ses bas, la façon dont il a travaillé pour se développer sur le plan artistique, musical et personnel, il y a beaucoup à apprendre de tout cela », explique Victoria Broackes. Elle rajoute : « Ce n’est pas seulement une histoire créative, mais une histoire démocratique d’ascension sociale, qui parle au commun des mortels. »
Des vitrines multimédias en 3D composent des tableaux mobiles et musicaux avec incrustations d’objets (guitare Framus à 12 cordes, saxo blanc en plastique du même type que celui de Charlie Parker, un blouson vert). Bowie déclare : « Cela aurait pu tourner autrement, j’aurais pu devenir Elton John ». Disons-le, David Robert Haywood Jones était un petit kéké à chapeau ou wanna be qui a réussi grâce à son intelligence et à ses rencontres. Il avoue lui-même dans une interview qu’il faisait exprès de glisser des livres dans sa poche pour frimer en intello ; sauf qu’il finissait par les lire. Sa grande influence est non pas Elvis mais le génial et oublié Little Richard qui s’est reconverti en prêtre malgré ses tenues folles d’antan.
Le spectateur s’esquiche en file indienne pour espérer lire les légendes avec des pièces disposées un peu en fouillis. Cafoutche et auto tamponneuse ! Là : une lettre du 17 septembre 1965 dans laquelle il annonce à son manager son changement de nom : M. Jones devient Docteur Bowie en référence au couteau à deux lames de James Bowie, mort à Fort Alamo ; il se démarque ainsi de Davy Jones, le chanteur des Monkees, un groupe de pop US passé aux oubliettes. De façon générale, la légende française est difficile à relier avec la pièce tant les objets sont nombreux (300, soit 120 caisses, piochés dans plus de 70 000 documents, dont au moins 60 000 photos, à 95 % extraits d’archives personnelles du méthodique Bowie, The David Bowie Archive, où une personne est affectée spécialement) ; pire pour les indications anglaises, bien du plaisir !
Major Tom pousse
Une vraie éponge, voire un opportuniste, comme Picasso ou Andy. Bowie a une propension, jugée fâcheuse par certains, à voler au secours de ses idoles, en plus ou moins bonne posture, artistique ou financière. Ainsi, il a produit (avec Mick Ronson) Transformer de Lou Reed, All The Young Dudes de Mott The Hoople (pour qui il a également signé la chanson-titre de ce LP) et Raw Power d’Iggy And The Stooges. Ses influences : le Velvet (voir le « test pressing » du premier disque du Velvet Underground and Nico, offert en 1966 par Andy Warhol qu’il rencontre en 1971 à la Factory, fiasco mondain où l’icelui est qualifié par l’anglais de « poisson froid », accusation dont il fait également l’objet : quand Bowie lui joue en acoustique son « Andy Warhol » (Hunky Dory, RCA, décembre 1971, LP produit par Ken Scott, un ingé son des Beatles, et David Bowie), le pape du pop art pète les plombs: « Il avait envie de rentrer sous terre ; je pense qu’il s’est senti dénigré dans la chanson… ») et la faute à Dylan. Il invente des processus de création, ses textes manuscrits de chanson comportant assez peu de ratures, parfois avec une écriture de bon élève, selon son état.
Ce sont les images du premier voyage sur la Lune de la mission Apollo 11 et de la Terre vue du ciel, qui vont faire décoller sa carrière. Il écrit alors Space oddity, en résonance au film 2001, l’Odyssée de l’espace (2001: A Space Odyssey, 1968) de Stanley Kubrick. La partoche est présente ! Accompagnant les images de l’alunissage qui tournent en boucle sur la BBC quelques mois après le début de la mission Apollo, le titre aux évocations spatiales va, après du temps pour s’imposer, connaître un immense succès. L’affiche du film est ici, nous planons. Le clip n’est pas encore inventé même si le scopitone existe, le mime fait fureur : Major Tom décolle, Bowie est en orbite. L’opportunisme de Space oddity a déplu à Tony Visconti, l’ami américain, qui a refusé de le produire. Tant pis, il accédera au Top 5 anglais. Le fond de la couverture de l’album est emprunté à Vasarely (op art ou art cinétique), que Bowie rencontra, qui me berça à Aix-en-Provence outre les magouilles du doyen Debbasch. Plus loin, le jeune publicitaire Bowie s’amuse à détourner l’image de la pochette des Beatles, Sgt pepper’s lonely hearts club band.
Si les connexions entre arts sont constantes, selon le principe de Lavoisier que rien ne se perd et tout se transforme « Son œuvre est très interconnectée avec elle-même, poursuit Victoria Broackes. Par exemple, dans l’expo, on peut voir le croquis du dos de la pochette de « Space Oddity », son deuxième album. Dessinée par la main de Bowie, y figure l’image d’un clown blanc à côté d’une vieille dame. Des personnages (l’Auguste d’Halloween Jack, costume créé par Natasha Korniloff) et une situation que l’on retrouvera dans le vidéoclip de « Ashes to Ashes », dix ans plus tard. Les idées cheminent dans l’esprit de Bowie, qui ne se contente pas de produire une chose après l’autre : ses créations relèvent d’un cortex sophistiqué et aux ramifications multiples ». Les connexions apparaissent alors comme des évidences : la proximité des pochettes de Heroes et de l’album The idiot d’Iggy Pop, les passerelles subliminales derrière les visuels de Scary monsters ou de The next day » avec son carré blanc que nous décrit son concepteur graphique.
L’odeur des sixties et du Swinging London est palpable pour l’ancien résident au Marquee (Blow Up, Michelangelo Antonioni, 1966). John Stephen, l’arbitre des élégances et son His Own Clothes à Carnaby Street plein de pantalons rouge sang, de turtleneck lilas et des shoes de daim gazon trouvés chez les gays new-yorkais ou italiens. Les affiches de concerts, un petit dessin bouddhiste, émouvant, placardé dans sa mansarde, les pochettes originales, le graphisme étant capital chez Bowie, contrôlant tout de A à Z. La guitare Gibson Les Paul, popularisée par Link Wray luit de mille feux.
Ziggy et alii
L’ensemble molletonné de Ziggy Stardust, réalisé par Freddie Buretti, un artiste rencontré dans la boîte gay, Le Sombrero, accentue, en 1972, la posture androgyne de Bowie qui était ici inspirée par le Droog Alex (Malcolm McDowell) d’Orange mécanique (A Clockwork Orange, S. Kubrick, 1971, d’après un texte de l’inventeur langagier Anthony Burgess). D’où la signalétique constamment orange.
Changeant totalement de look et multipliant les déclarations tapageuses, Bowie pique sans vergogne à Vince Taylor, à l’enseigne Ziggy dans l’East side. L’et, aux cheveux rouges, grâce à la femme de Mick Ronson, à l’ensemble veste-pantalon ajusté avec des bottines rouges à lacets, une guitare bleue, des ongles vernis de blanc, devient l’idole des teen-agers anglais, à l’instar de Marc Bolan de T. Rex, avec qui il travaillera (affiche du concert de Tyrannosaurus Rex, dont Bowie assure une première partie avec un spectacle de mime façon Marceau en soutien à la cause tibétaine ; dans leur seul enregistrement officiel, il couche un solo dans The prettiest star, Mercury, juin 1970, 45T produit par Tony Visconti, même si l’ambiance n’était pas au poil aux studios Trident ; lorsque, trois ans plus tard, Bowie réenregistrera la chanson avec les Spiders from Mars pour Aladdin Sane, Ronson dupliquera le solo de Bolan à la note près) avant de se brouiller. Ziggy évolue, avec son groupe rebaptisé les Spiders from Mars, dans des décors réalisés par George Underwood, au rythme des chorégraphies de Lindsay Kemp et dans des costumes extravagants de Natasha Korniloff (« l’ultraviolence en tissu liberty »). Une émouvante photo avec un Bowie en bleu électrique, cheveux rouges et platform boots en vinyle, qui chante Starman à la télé anglaise pour Top of the Pops le 6 juillet 1972 en tenant par l’épaule le regretté guitar heroe mort d’un cancer du foie, Mick Ronson : Bowie fédère dès lors les adolescents mal dans leur peau, les parias, les hétéros frustrés, les gays refoulés ou non et tous les déprimés, pour qui il devient un dieu. Il plonge alors la pop dans « une ère faite de mode, de théâtralité et de sexe ». Dès le lendemain, raconte Marc Almond, l’ancien leader de Soft Cell, tout le monde se demandait dans la cour de récréation « s’il était queer parce qu’il avait aimé ce Starman androgyne ».
Bowie tue Ziggy Stardust au sommet de sa gloire dans un mythique concert à Londres, dans un Hammersmith Odeon sold out, le 3 juillet 1973 où le public admire une avalanche de satin, de soie, de couleurs flashy, de maquillages outranciers, de chaussures à semelle compensée et de poses équivoques. David Buckley dans la biographie fouillée David Bowie, une étrange fascination, explique : « Le petit garçon de 3 ans s’est découvert une fascination ‘contre nature’ pour la trousse de maquillage de sa mère. « On aurait dit un clown, déclarait Peggy, sa mère, en 1985. Quand je lui ai expliqué qu’il ne devait pas se maquiller, il m’a répondu : ‘Tu le fais toi.’ J’ai dit oui, mais que ce n’était pas pour les petits garçons. » ». Les gays sortent du placard (John i’m only dancing) à qui il fait un clin d’œil en mimant le sexe oral avec la guitare de Mick Ronson. Qui sait que Jeff Beck a joué (The Jean Genie, Love me do, Round And Round), bien qu’absent du film de DA Pennebaker (Ziggy Stardust and the spiders from Mars, 1973)? La qualité de son jeu ou sa tenue ce soir-là en seraient la cause, mais la pingrerie du manager Defries était telle qu’il est fort possible qu’ils ne se soient pas mis d’accord sur le salaire que le musicien devait obligatoirement percevoir pour sa participation à un concert filmé.
Derrière une vitrine, Bowie fait encore scandale en apparaissant trois fois en travesti dans le clip drolatique Boys keep swinging. Un très beau costume noir sobre avec chaussures à talons discrets, le tout n’aurait pas été renié par YSL. « Ladies and gentlemen and others ». Une tenue stricte portée lors de la remise d’un Grammy Award à Aretha Franklin, dont il ne se sentait pas digne, à l’Uris Theatre de New York le 1er mars 1975 : https://www.youtube.com/watch?v=xUu-_F9vWnk . Et un Hamlet sans casser les œufs avec crâne comme vanité au pied.
Le glam avant la tempête
Passons au glitter ou glam. Un mix remarquable empiète sur les chants au casque. Trop de db sur DB ! Au passage, I’m afraid of americans » (album Earthling, 1997 où Trent Reznor de Nine Inch Nails, dans un remix, zone et file à donner des sueurs froides dans le clip boosté de Dom et Nick) avait été mis à fond lors du 11 septembre 2001, date d’ouverture dudit XXIe siècle, avec The star-spangled banner repris par Jimi Hendrix. J’aurais pu mettre à fond aussi This is not America avec le guitariste de jazz Pat Metheny et son acolyte pianiste, Lyle Mays, extraite de la BO du film de John Schlesinger The Falcon And The Snowman (Le jeu du faucon, 1985). Bowie côtoie nos vies et l’histoire avec sa grande hache aspirée. Des costumes de Yamamoto, avec force kimono avec, au dos, David Bowie en idéogrammes, le styliste témoignant avec un atroce collier corail et une veste multicolore à faire rire. Beaucoup de costumes ont été créés à une période par Buretti. Un clip dada avec Joey Arias et Klaus Nomi au chœur, repéré comme mannequin vivant dans une vitrine de magasin, pour un Hypnotic performance au SNL (1979). Engoncé dans son costume de Brooks Van Horn inspiré du Cœur à gaz de Tzara mélangé avec la géniale Sonia Delaunay, les deux folles robotiques aux voix d’or transportent Bowie jusqu’au micro … Le génie côtoie le ridicule : ils y vont à fond ! (« The man who sold the world » : https://vimeo.com/49104160). J’avais découvert cette chanson grâce à la reprise de Nirvana dans leur célèbre MTV Unplugged à New York en 1994.
Le plus impressionnant est le verbasizer, un logiciel développé spécialement pour Bowie dans les années 90, générant des phrases aléatoires : il pioche au hasard dans les 5 colonnes lors de ses concerts. Il retrouve ainsi le cut up de Burroughs (voir le manuscrit de la chanson Blackout sur Heroes, RCA, octobre 1977, LP produit par Bowie et Visconti ; un moment, il pose lors d’un shoot – photo ! – avec un jean grunge devant une photo en noir et blanc de lui avec le pape du beat). Interconnexion, encore et toujours.
Passés une lettre d’hommage (1976) d’Elvis, bourré d’amphét’ avec couronne hawaïenne, à Bowie, des échanges entre Bolan et Bowie, des scénos de Baal d’après Brecht (téléfilm diffusé en 1982 par la BBC ; cf. Volker Schlöndorff, 1970 avec Rainer Werner Fassbinder) dans une fraîcheur toute rimbaldienne teintée de romantisme allemand. Sa veste anthracite de 1982 (Baal, RCA, février 1982, EP de 5 chansons, produit par Visconti et Bowie) repose sur une table. La photo de Lily Marlène façon Harcourt. Une belle fille se trouve mal et se repose sur un trop rare siège. Un storyboard arty d’un projet inabouti autour d’Hunger City. Baste, elle rate le costume de l’Union Jack lorsque Bowie a sollicité le génial et regretté Alexander McQueen, alors jeune diplômé de la Saint Martins School de Londres, pour cette création portée sur la tournée Earthling en 1997. L’artiste a été inspiré notamment par la veste aux couleurs du drapeau britannique de Pete Townshend des Who. « Il a mélangé une esthétique très punk, ces déchirures, ces brûlures de cigarette, avec cette tradition du tailleur britannique classique, ce qui est très Bowie », commente Victoria Broackes. « A l’époque, Alexander McQueen n’était pas encore très connu du grand public. Mais Bowie a toujours su travailler avec les gens les plus extraordinaires et intéressants ». Arrêt sur musique : Earthling (aux manettes Reeves Gabrels et Mark Plati, 1997) est l’album enthousiasmant, mis en boîte à New York aux studios Looking Glass, qui m’a fait redécouvrir un énième Bowie en revisitant son album complémentaire Outside (BMG, septembre 1995, LP produit par David Bowie, Brian Eno et David Richards ; encensé par Françoise Hardy ; le tripal A small plot of land, le liquide et crooner The motel, l’ambiancé d’Eno pour Wishful Beginnings, I’m deranged choisi magnifiquement par David Lynch pour l’ouverture sidérante de Lost Highway, 1997) dont la pochette est peinte par Bowie himself. Le concept était inédit : l’album était, sur internet, découpé en segments dans chaque chanson, un studio virtuel était reconstitué et chaque internaute pouvait composer son album. Comme Pete Gab’, Bowie et les NTIC. Toujours avec un déclic d’avance, la critique a été désarçonnée face à cet album jungle-drum’n bass. Les délires guitaristiques et claviéristes rappellent le piano rock de Mike Garson de la chanson-titre sur l’album Aladdin Sane. J’étais tellement aux anges que je voulais voir la tournée de Bowie mais c’était à Toulon dont la mairie était FN à l’époque. Ethique de conviction.
A côté, le costume toile d’araignée à fausses mains inventé par la costumière Natasha Korniloff en 1973, arboré par Bowie lors d’un spectacle diffusé sur la télévision américaine, deux mains dorées viennent recouvrir la poitrine. Composé d’un filet noir évoquant une toile d’araignée révélant largement le corps, cette tenue comportait à l’origine une troisième main sur l’entrejambe. Mais jugée indécente par la chaîne, cette main a finalement été remplacée par une sorte de legging. A côté des maquettes de la tournée, la censure rôde dans Diamond dogs où le sexe aurait dû apparaître sur la pochette de l’album, planche contact à l’appui. D’ailleurs, la dystopie, hantée par l’expressionisme de Metropolis (Fritz Lang, 1927), dont l’affiche est présente, Diamond Dogs (RCA, mai 1974, LP produit par David Bowie, mixé par Tony Visconti), avec Halloween Jack, est né du refus des ayants-droit d’adapter 1984 de George Orwell. Censure aussi sur le papier peint Laura Hashley dans les années 90 où Bowie tenait à représenter des sexes en dessinant des personnages ! L’artiste est aussi protéiforme que le génial Kurt Schwitters, du design papier à en-tête jusqu’au metzbau en passant par la marqueterie, la poésie sonore ou écrite, les collages et tableaux. Un artiste à part entière, un adepte du rock théâtral et de la performance au même titre qu’Alice Cooper.
Ciné, théâtre, mime
Une salle projette des extraits de films, où Bowie se révèle meilleur qu’Elvis mais n’apparaît pas comme un immense acteur.
L’homme qui venait d’ailleurs (The man who fell to earth, Nicolas Roeg, 1976, adapté d’un roman de l’Américain Walter Trevis, L’Homme tombé du ciel, 1963), où David Bowie incarnait de façon plaisamment étrange, Thomas Jerome Newton (cf. le pendant féminin Scarlett Johansson en The Female dans Under the Skin, Jonathan Glazer, le film le plus important de 2013), vu à l’Institut Lumière. C’est en regardant Cracked Actor, le documentaire d’Alan Yentob sur la tournée Diamond Dogs, que le cinéaste Nicolas Roeg a eu l’idée de faire appel à David Bowie. Ce film est important car il contribuera au processus de reconstruction amorcé par l’artiste dès 1975. Conscient que pour échapper aux abus qui lui détruisent la santé il va devoir regagner l’Europe, Bowie utilisera l’album Station to station comme véhicule. Pour la scène, il va inventer un nouveau personnage, le fameux Thin white duke, qui doit beaucoup à l’extraterrestre du film. Bowie mettra une photo de Thomas Jerome Newton en couverture de l’album et de son successeur (Low en 1977). A la fois perdu et déterminé, le Thin white duke, comme Newton, porte un costume sombre (avec ou sans veste) sur une chemise blanche et va tout mettre en œuvre pour échapper à son destin. Aussi, parce qu’on lui refusera la possibilité d’en signer la bande originale, Bowie virera son manager d’alors et trouvera l’équilibre, notamment budgétaire, en présidant à son destin. Enfin, et même si très peu de ce qu’il avait enregistré pour le film avec Paul Buckmaster s’est retrouvé sur Low (quelques pistes du morceau Subterraneans), il est possible d’affirmer que les faces B des deux premiers albums du triptyque européen, sous influence krautrock, doivent leur caractère de musique de film à The man who fell to earth.
En 1983, en voie de starification globale assumée, David Bowie publie en avril l’album commercial Let’s dance que Nile Rodgers-l’homme-qui-touche-de-l’or-avec-sa-basse (de Chic à Daft punk), produit avec bisbille en sus avec Stevie Ray Vaughan. Avant de partir en tournée mondiale marathon, Bowie passe par le festival de Cannes pour le rôle du Major anglais Jack ‘Strafer’ Celliers, avec une scène de mime lourde dans sa geôle, tout comme celle de ses débuts projetés à côté (que Cassavetti juge, à juste titre, neuneu dans The mask (a mime), de 1969, dans lequel David joue le visage blanc) dans Furyo (Merry Christmas Mr Lawrence, 1983, le transgressif, politique et colérique Nagisa Ôshima avec la célèbre musique de Ryûichi Sakamoto, leader de Yellow magic orchestra, et une des premières apparitions de Takeshi Kitano). Lors de la tournée Serious moonlight tour, il s’inspire du personnage de Celliers : la chromie légèrement passée et dominante du film (le beige des uniformes, le gris-vert de la forêt, l’orangé du sol) va se retrouver dans les costumes pastel portés durant la tournée et l’éclairage de la scène, bien plus chaud que les néons crus.
Le voici en Jareth the Goblin King, « Your eyes can be so cruel, just as I can be so cruel » dans le dispensable Labyrinthe (Labyrinth, Jim Henson, 1986) produit par Lucasfilm, loin du magique Dark crystal (The dark crystal, Jim Henson, Frank Oz, 1982, revu en copie 35 mm à un Epouvantable vendredi à l’Institut Lumière avec le prince du mauvais genre, Fabrice Calzettoni, en présentation). Une musique écrite par Bowie.
Le kitschissime Absolute beginners (Julien Temple, 1986), d’après un roman culte de Colin MacInnes avec cette épouvantable chanson-titre enregistrée à Abbey Road avec, pourtant, l’excellente chanteuse Sade en duo, qui tournait sans cesse à la radio jusqu’à la saturation. Digne d’une prestation d’Elvis, hum, bon, né le même jour, un 8 janvier.
Sollicité par l’artiste/réalisateur Julian Schnabel (Basquiat, 1996), Bowie interprète Warhol jusqu’à porter, sur le tournage, perruque, lunettes et blouson ayant appartenu au maître de la Factory.
Plus surprenant, alors que Ashes to ashes cartonne, un extrait de la pièce The Elephant Man à Broadway, carton d’invit’ à l’appui, où Bowie se révèle sidérant en Merrick, figure qui est également visible dans Under the skin (Jonathan Glazer, 2013). La lettre d’hommage de John Hurt, excellent dans Elephant man (The Elephant Man, David Lynch, 1980), à Bowie est émouvante. Sont exposés l’austère pagne en bure porté au théâtre pour « The elephant man, les modestes sandales portées dans La dernière tentation du Christ (The last temptation of Christ, 1988) de Martin Scorsese.
Clips clac
Perclus de fatigue, je me hisse à l’espace clips. Là, des diffusions de clips sur écrans à l’ancienne, selon votre disposition physique sur l’échiquier. Des gens se disposent inévitablement devant moi, je les hèle à la main. Une masse façon banquier Stern sans latex, une nana sévèrement lookée se déhanche.
Le clip de DJ (musique d’Eno et Carlos Alomar, sur Lodger, RCA, mai 1979, LP produit par Bowie et Visconti), que je ne connaissais pas, assez simple, dans une rue où Bowie se fait rouler des patins par les deux sexes, à l’improviste, à Londres.
Où l’on apprend que lors d’Ashes to ashes (Scary monsters), le clip le plus cher de l’époque avec force couleurs solarisées et noirs et blancs, des gens ont été recrutés à la va-vite dans un night-club pour jouer sur une plage. Steve Strange, du groupe Visage, mort récemment, et les Blitz kids de Berlin y apparaissent avec bulldozer dans le dos. Major Tom se révèle junkie.
Le clip de David Mallet pour l’insupportable Let’s dance, avec Bowie fringué en homme d’affaire Mugler, en mémoire de son pitoyable groupe Tin machine lors de sa traversée du désert (Tin Machine, EMI, mai 1989, LP produit par Tin Machine et Tim Palmer ; Tin Machine II, Victory Music, septembre 1991, LP produit par Tin Machine, Tim Palmer et Hugh Padgham). Jump they say (Black tie white noise) avec son look de salaryman (il venait de se marier avec la mannequin Iman Abdulmajid qui lui fit rencontrer Al B Sure pour la chanson-titre de l’album). Au passage, une reprise du Moz Morrissey (I know it’s gonna happen someday) est à tomber. Un remix Fame ’90 clippé par Gus Van Sant, paru en single en 1990 à l’occasion de la sortie de la compilation ChangesBowie.
Je chante les basses sur Hallo spaceboy (Earthling) remixé par Pet Shop Boys, une redécouverte très enfouie. Du même album, Floria Sigismondi se colle le speed Little wonder avec un luciférien Bowie dans son costume noir présenté à côté : délire assuré. Dans un autre clip de l’icelle sur The stars (are out tonight) (The next day, ISO, mars 2013, LP produit par Bowie et Visconti et enregistré à New York), digne d’un film, avec crédits au générique (comme Thriller de John Landis avec M. Jackson le 02 décembre 1983), Tilda Swinton, le pendant physique de Bowie, pète les plombs avec les cheveux explosés tout en coupant une volaille façon Massacre à la tronçonneuse.
L’artiste Tony Oursler, vu au Jeu de Paume, aux commandes du clip de la chanson lente au refrain sépia We are we now (The next day), avec les retrouvailles avec Berlin (Potsdamer Platz, KaDeWe) tourne dans la tête avec persistance. Voilà pour les années MTV, aucun média n’échappant à Bowie.
Heureusement, nous avons échappé au ridicule Dancing in the street filmé par David Mallet en 1985 avec Mick Jagger, un single caritatif enregistré à l’occasion du Live Aid repris du classique de la soul popularisé par Martha And The Vandellas, où ils ont font des tonnes à London Docklands en multipliant mimiques, simagrées, gambades et sauts de cabri façon jogging.
Pas de Never let me down (EMI, avril 1987, LP produit par Bowie et David Richards), chanson-titre en hommage à l’assistante de Bowie, Coco Schwab, avec l’inévitable Mondino. Ouf !
I & US
Terrorisé par le souvenir de ses débuts, Bowie est obsédé par l’idée de renouvellement. Il file donc aux Etats-Unis avec force gomina (Dapper Dan ?) et coco dans les naseaux. Il se penche sur la musique noire préfigurant la disco favorite du milieu gay et décide de sortir un album dansant, Young americans, qui laisse tout le monde perplexe mais séduit les Yankees en 1975. Il côtoie l’Apollo Theater et recrute les meilleurs choristes. Bien qu’aguerris, ils comprennent mal la façon, déconstruite, d’écrire du « godardien » Bowie. Disons-le, ils en baveront en studio (sur Arte : David Bowie en cinq actes de Francis Whately GB, 2013, 60 min). Lennon participe au chœur sur l’hypnotique Fame, une reprise des Flares, qu’il coécrit avec le fameux riff funcky d’Alomar. Désormais exilé à Los Angeles où il vit dans une maison encombrée d’objets liés à l’occultisme égyptien, il détruit sa santé, maigrit, voit des sorcières, fait exorciser son logis et pense que Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin, adepte d’Aleister Crowley, lui veut du mal. Enfermé dans sa chambre, les rideaux noirs invariablement clos, il lit The spear of destiny de Trevor Ravenscroft qui présente le nazisme comme une société secrète née de l’occultisme XIXe siècle, se passionne pour Goebbels « à cause de la façon dont il a utilisé les médias » et est fasciné, comme Dali, par les nazis pour « leur quête du Graal ». En 1976, cette photo de Bowie période The man who fell to earth, revenant de tournée à Victoria Station, et faisant un salut nazi devant sa cohorte de fans, avait terriblement choqué. Quelque temps auparavant, dans une interview à Playboy, il avait expliqué qu’Hitler était la première rock star avant Mick Jagger. Il parle de Golden dawn dans certaines de ses chansons, sans oublier la notion de surhomme chez Nietzsche, présente très tôt (After all dans The man who sold the world , 1971). Cette partie sombre, démontrant la complexité du personnage, est gommée de l’expo, dommage. Et, pour cause : Bowie a fait supprimer des agences de presse toutes les photos compromettantes. Entouré d’un aréopage de serviteurs censés le couper du monde, l’artiste, à qui il arrive de ne pas dormir pendant une semaine, est en chute libre. Hautain, agressif, maladivement avare depuis qu’il a compris que son manager, Tony Defries, lui a fait signer un contrat qui garantit de le ruiner, Bowie enregistre néanmoins un chef-d’œuvre moderne, Station to station. Celui qui a peur de l’avion et se surnomme désormais le « Mince duc blanc », fantasme sur le Vieux Continent.
BerlIggy
Passant donc de la coke de la californication à l’héro dans la ville divisée en deux, le squelettique et blafard Bowie, amateur de la période de Weimar, se rassérène en Europe. La salle berlinoise, l’une des plus réussies, avec un plan de Berlin mangé par les pas et prolongé par des écrans avec diffusion de musique influencée par Kraftwek et autre kosmische musik (Can, Faust, Neue, etc.), expression plus pertinente que Krautrock. La trilogie, faussement berlinoise, est nommée, selon Bowie et Eno, adepte de la Stratégie Oblique, trilogie européenne. Seul l’album Heroes a été intégralement enregistré à Berlin, aux studios Hansa, près du mur. Le synthétiseur analogique AKS à l’origine de la trilogie Low, Heroes et Lodger (enregistré à Montreux et mixé à New York), offert à Bowie en 1999 par Brian Eno, trône, majestueux, après le Stylophone pour Space oddity », le Mellotron et autres machineries. Le romantique germanophile appréciera les photos du chanteur en apnée expressionniste, d’un Iggy Pop au piano, peint par Bowie de façon peu originale mais très Die Brücke, avec images originales à l’appui (Erich Heckel), ou du studio installé entre deux miradors. Sur le côté Iggy, la collaboration de Bowie avec Pop est aussi d’un intérêt bien compris : Bowie accompagne l’iguane comme claviériste lors de sa tournée de 1977. Au milieu des années 80, Bowie reprend à son compte certaines des chansons écrites à quatre mains, mais avec davantage de succès (China girl).
France
Bonus. La salle française, prétexte à conf’ de Soligny. Une longue histoire d’amour pour Bowie, dont l’un des regrets est de ne pas être sorti avec Françoise Hardy. Un registre manuscrit stipule la venue de David Bowie & The Lower Third à la discothèque parisienne le Golf-Drouot, les 31 décembre 1965, 1er et 2 janvier 1966, pour « 2 000 F, hôtel en plus ». Un publi-rédactionnel extrait de Golf-Drouot Actualité, où Robert Madjar fait la promotion dudit Bowie et d’un autre jeune chanteur, Arthur Brown : « Vous ne serez pas déçus après les avoir découverts. Et comme les jeunes Anglais du Marquee, vous les réclamerez à nouveau, j’en suis sûr ». Qu’on se le dise, Bowie s’est produit à Paris dès 1965 ! Cocorico même : la France est le premier pays où il tournera en extérieur.
Les enregistrements épiques de Pin ups (juillet 1973), The idiot d’Iggy, produit par Bowie, Low (septembre 1976 ; titre de travail : New Music : Night And Day ; méthode de travail : rythmiques jetées sur bande à la hâte, beaucoup de temps consacré à l’enrichissement du son, prises de voix rapides) au milieu des années 70 s’effectuèrent au château d’Hérouville, un studio créé par le musicien opportuniste Michel Magne, vers Pontoise, près de Paris. Matons le livre d’or du château d’Hérouville avec les paroles d’une chanson enregistrée in situ. Laurent Thibault, ingénieur du son audit château, se remémore les séances d’enregistrement. Il s’amuse de l’image bisexuelle de Bowie : « Je n’ai jamais vu un homme courir autant après les femmes ». Bowie est même passé au Havre, embarquant sur le France en avril 1974. Côté people et glamour, c’est un grand amoureux de la France, de sa littérature (le précieux ronsardien Jean Genet en particulier), de Paris où il a demandé Iman Abdulmajid en mariage sur un bateau-mouche. Etape fondamentale que la France : il se débarrasse des sales tics chopés aux USA entre 1974 et 1976, ainsi que d’un management jugé aussi néfaste qu’inefficace. Au tournant de la décennie, Bowie va également rompre avec Angie, obtenir la garde de leur fils, Zowie, et devenir maître de sa carrière, notamment sur le plan pécuniaire. 2004 : crise cardiaque. Bowie a essaimé via Suede, Placebo et tant d’autres.
Coda
Dépôt des casques. Une salle hallucinante en clôture : 21’ de bonheur sur 360° avec trois extraits de concert (dont Ziggy évidemment, le très rock The Jean Genie avec Bowie à l’harmonica). Deux vieilles braillent pour continuer la conversation. Un couple d’étudiants rit de leurs amis asiatiques. Je me cale en diagonale sur d’immenses pouffes pour jouir de la vue, une belle cuivrée se pose à côté de moi. Encore des costumes (Alexander McQueen, Thierry Mugler, etc.) éclairés en son et lumière pendant le passage des concerts, des objets, encore des objets, une maquette pop délaissée car le décor était trop onéreux ainsi que celle du pharaonesque Glass spider Tour (1987) avec son araignée géante au-dessus de la scène, ses musiciens (Peter Frampton à la guitare !) et ses six danseurs (parmi lesquels Melissa Hurley, petite amie de ces années-là).
Was is will. Sortie à 17h après 6 heures d’immersion Bowienne. Les sens ont été convoqués. J’ai peut-être mal lu, mais il manque la référence fondamentale à Scott Walker, que Bowie tenta d’imiter comme crooner, allant jusqu’à lui piquer sa petite amie et à chanter Brel lui aussi ! Tout le parcours du rocker, décrit par Cyrille Martinez dans Musique rapide et lente (collection Qui vive, édition Buchet-Chastel), est respecté.
Las des produits dérivés, livres en pagaille, 45t pressés pour l’occasion, dont Heroes, en vinyle bleu sous pochette semblable à celle de l’époque, chanté en français, la belle affaire ! L’homme d’affaire Bowie, excellent marketeur, en a profité pour caler la sortie de The next day avec l’expo anglaise. Une visite filmée de l’exposition version V&A, David Bowie is happening now (Hamish Hamilton, Katy Mullan, 2013), est projetée dans plusieurs dizaines de salles de cinéma Gaumont Pathé en France. Wiebo, une commande, est un concert performance imaginé par Philippe Decouflé et composé de reprises de chansons de Bowie interprétées par Sophie Hunger, Jehnny Beth et Jeanne Added avec artistes de cirque et danseurs. Une orchestration in vivo de 2001, l’Odyssée de l’espace (2001: A Space Odyssey, 1968) de Stanley Kubrick à la Philarmonie. Ce week-end SF inflige en before un travail indigent de Jeff Mills, l’ancien DJ d’Underground resistance à Detroit en quête de légitimité, avec chorégraphie nullissime à la Cité de la Musique sur fond de monolithe rose … L’expo part en Australie (Melbourne) puis aux Pays-Bas (Groningen).
LouBez m’attend à la Cité de la Musique avec des Paul Klee provenant de collection particulière, une trilogie Bacon de la Tate modern, jamais vue malgré la rétro à Pompidou, des magnifiques Vieira da Silva, des photos en noir et blanc de Lucien Clergue, une installation sonore multicanale de Repons, joué à la carrière Boulbon à Avignon, des partitions, l’émouvant original d’Un coup de dé jamais n’abolira le hasard de Mallarmé de chez Doucet !