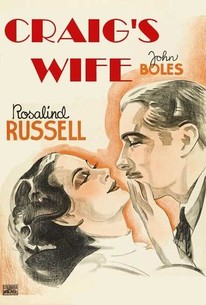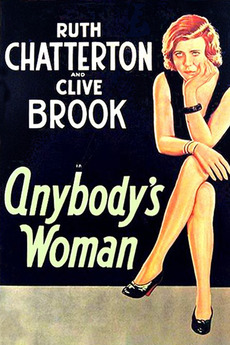Le Masque arraché, Sudden fear, David Miller, 1952, noir et blanc, 1h50, 1:37, numérique, Institut Lumière, Hangar

Magie de la traduction : Le Masque arraché n’apparaît pas comme tel au générique, même en traduction ; Sudden fear, titre original, est plus juste. Une sacrée découverte : après une passionnante installation de personnages, le scénario vire et vous prend littéralement. Un hommage à la poésie sonore avec Palance / Blaine ?
L’ambassadrice Delphine Gleize (Carnage, 2002 avec Chiara Mastroianni ; L’homme qui rêvait d’un enfant, 2006 ; La permission de minuit, 2011 avec Vincent Lindon et Emmanuelle Devos) présente.
Miller’s crossing
David Miller (1909, le Paterson de W. C. Williams, New Jersey ; 1992, Hollywood, Los Angeles, Californie), réalisateur, producteur de cinéma et scénariste américain, vient du documentaire. Solide technicien, il a été assistant sur la série de propagande (Pourquoi nous combattons, 1941-1944, Capra, Litvak, Ford, etc.). Montrant les prémisses de la seconde guerre mondiale, coté Pacifique, il tournera Les tigres volants (Flying Tigers 1942) avec John Wayne et Le défilé de la mort (China, John Farrow, 1943 avec Loretta Young et Alan Ladd). Il y eut aussi le film de guerre Le Combat du Capitaine Newman (Captain Newman M.D., 1963) avec Gregory Peck, Tony Curtis, Angie Dickinson et Robert Duvall.
Bertrand Tavernier défend Saturday’s Hero (1951). Le Réfractaire (Billy the Kid, 1941) ne reste pas dans les annales tant le film a vieilli, à cause d’un Robert Taylor qui ne correspondait pas au rôle. David Miller se montre à l’aise dans tous les genres, de la comédie burlesque comme le navrant La pêche au trésor (Love happy, 1949), un pastiche de film policier, l’un des derniers films des Marx brothers, et pour la première fois à l’écran Marilyn Monroe, le thriller dispensable en couleurs avec Doris Day et Rex Harrison qui reprend le thème de Sudden fear, Piège à minuit (Midnight lace, 1960), le film historique avec Diane de Poitiers incarnée de façon très glamour par Lana Turner ou le film de politique-fiction comme Executive action (1973), inspiré de l’assassinat du président Kennedy avec Burt Lancaster et Robert Ryan.
David Miller était apprécié du scénariste blacklisté Dalton Trumbo. Après avoir écrit Seuls sont les indomptés (Lonely are the brave, 1962, avec Walter Matthau, Gena Rowlands, Michael Kane, Georges Kennedy), Dalton exigea qu’il fut chargé de la mise en scène d’un autre de ses scénarios, Complot à Dallas (Executive action, 1973) avec Burt Lancaster. En outre, pour rassurer les assurances durant le tournage de Johnny s’en va-t-en guerre (Johnny got his gun, 1971), Trumbo nomma Miller comme la personne chargée de terminer le film en cas de problèmes.
Elle a les Craw, Joan
Si Miller fut le metteur en scène du western crépusculaire à succès Seuls sont les indomptés (Lonely are the brave, 1962), où il fut éclipsé par le producteur et acteur principal du film, Kirk Douglas, tel n’est pas le cas ici, alors que c’est le premier film de Joan, comme productrice s’entend, en tant qu’indépendante après avoir pris congé de la Warner, en osmose avec David. Elle a personnellement engagé Lenore J. Coffee comme scénariste du film, suggéré Elmer Bernstein, dont c’est l’une des premières compositions, reprise en partie dans Robot monster (Phil Tucker, 1953), en tant que musicien. Elle a insisté pour que Charles Lang soit embauché comme directeur de la photographie du film et a demandé à jouer avec Jack Palance, même si Clark Gable fut un premier choix puis Marlon Brando, et Gloria Grahame, deuxième choix après Jean Rogers.
Pour Antoine Sire, « Joan Crawford eut au moins cinq carrières : vamp des Années folles, femme du peuple au parcours sulfureux de l’ère pré-Code, vedette flamboyante de l’avant-guerre, héroïne de films noirs et de mélodrames dans l’après-guerre, monstre vieillissant pour thrillers grand-guignolesques dans les années 1960. Ses yeux immenses sont la constante de son physique à toutes ces époques. Ils sont des fenêtres ouvertes sur le tréfonds d’une âme féminine, souvent noircie par des scénarios misogynes. » (Sire, Antoine. Hollywood, la cité des femmes. Paris, Lyon : Actes sud / Institut Lumière, 2016. 1206 p. 59 €).
Lucille LeSueur dite Joan Crawford (1907, Texas ; 1977, New York) a été très tôt attirée par la scène car son beau-père était propriétaire d’un théâtre à Lawton (Oklahoma). A l’âge de treize ans, elle remporte un premier concours de danse puis œuvrera à Broadway. Repérée par la MGM, c’est l’une des stars les plus représentatives de l’âge d’or d’Hollywood. Elle débute en 1925 dans le muet, dans de petits rôles de figurantes (Les feux de la rampe, Pretty ladies, Monta Bell). Les studios s’intéressent surtout à son physique de pin-up : visage carré, grande bouche, yeux immenses. Elle cumule les rôles de petite amie du caïd dans des films de gangsters. Après d’être battue, elle arrache son premier rôle important dans Old clothes (Edward F. Cline, 1925). Elle interprète Diane dans Les nouvelles vierges (Our dancing daughters, Harry Beaumont, 1928).
Elle incarne la jeunesse américaine des années 1930, insouciante et assoiffée de vie comme chez F. S. Fitzgerald, et fait rêver une génération de midinettes. Jusqu’en 1943, elle reste fidèle à la MGM, pour laquelle elle tourne une trentaine de films, dont Mannequin (1937) de Frank Borzage.
Elle démarre une deuxième carrière après la Seconde Guerre mondiale où tous types d’interprétations lui sont confiées : de la femme cynique à l’intrigante, en passant par la femme fatale sophistiquée ou aventureuse. Elle gagne l’oscar de la meilleure interprétation féminine grâce à son personnage de mère meurtrière par amour pour sa fille dans le remarquable Le roman de Mildred Pierce (Mildred Pierce, Michael Curtiz, 1945). Toutes ses apparitions se soldent alors par un succès commercial. Elle enchaîne les mélodrames dans lesquels elle personnifie la femme qui a vécu seule pendant les années de guerre et qui rêve d’amour.
Joan fut nominée pour l’Oscar face à Bette Davis, leur seul et unique face à face. La majorité des films suivants de Crawford étaient des productions mercantiles sans grand intérêt.
Entre deux âges, elle n’hésite pas ici à se montrer vieillissante. Elle multiplie les expressions : la peur, la trahison, le désespoir, la haine. L’essentiel réside dans sa réaction aux évènements dans le film. Elle joue deux visages, rêve de toute actrice : l’un, rassurant et amoureux, pour son amant Lester quand elle lui fait face, un autre plus cynique dès qu’il a le dos tourné. De vieille fille frustrée, seule, méfiante, sèche et réservée avec ses regards durs et ses mâchoires crispées, elle devient une femme fatale. Elle est omniprésente (seule dans son bureau, en répétition, dans sa chambre ; elle manigance un plan machiavélique ; elle est coincée dans un placard ; elle s’enfuit) et parfois exaspérante avec ses grands yeux et sa bouche qui se tord, comme plus tard Laura Dern (Inland empire, D. Lynch, 2006), remémorant dans certains gros plans, où elle mime l’effroi par exemple (voir les expressions terrifiées dix ans plus tard dans Qu’est-il arrivé à Baby Jane ?, What ever happened to Baby Jane ?, Robert Aldrich, 1962), Gloria Swanson imitant excellemment le muet dans Boulevard du crépuscule (Sunset Boulevard, Billy Wilder, 1950). Dans le dernier tiers du film, le rôle de Joan est presque entièrement muet. Deux moments forts : quand elle apprend son infortune dans une scène où le son est mis en scène, avec parfois une peur générée par des bruits communs, comme plus tard, Conversation secrète (The Conversation, F. F. Coppola, 1974) ; quand elle va finalement renoncer à son projet. A la fin, les gros plans, qui se reflètent dans un miroir, s’accumulent sur son visage ravagé par la haine à cause des deux amants.
Qui s’en Palance ?
Vladimir Palahnuik (1919, Lattimer, Pennsylvanie ; 2006, Montecito, Californie) dit Palance, second couteau d’Hollywood, fils d’un mineur d’origine ukrainienne, fut un boxeur professionnel dès 13 ans, un cuistot, un réparateur de radios, un vendeur de glaces, un maître-nageur, un garde du corps qui intégra l’Air Force en tant que pilote de bombardier où il hérita de ce visage suite à une opération de chirurgie esthétique à cause de l’incendie de son avion. Il bénéficia d’une bourse et s’inscrivit à l’université où il suivit des cours d’arts dramatiques et décrocha un diplôme en 1947.
C’est la doublure d’Anthony Quinn, qui a repris en tournée le rôle de Stanley Kowalski, créé par Marlon Brando, qui s’entraînait à la boxe en attendant de monter sur scène, dans Un tramway nommé désir (A streetcar named desire), pièce de Tennessee Williams mise en scène par Elia Kazan. C’est ce dernier qui lui donne sa chance au cinéma avec un rôle de méchant dans Panique dans la rue (Panic in the streets, 1950). Grand (1,93 m), mince, cheveux noirs, nez cassé, pommettes saillantes, yeux enfoncés sous des arcades proéminentes, doté d’une voix profonde, il devint l’interprète idéal de personnages de tueurs (L’homme des vallées perdues, Shane, George Stevens, 1953 où, en tant que tueur aux gants noirs au sourire sadique, il donne la réplique à un Alan Ladd monté sur un escabeau ; en 1955, reprise, dans la Peur au ventre, I died a thousand times, Stuart Heisler, 1955, du rôle de Roy Earle qu’avait tenu Bogart dans La grande évasion, High Sierra, Raoul Walsh, 1941; Les Professionnels, The Professionals, Richard Brooks, 1966, où il incarne ce hors-la-loi mexicain qui a enlevé Claudia Cardinale, recherchée par la bande de mercenaires menés par Burt Lancaster), d’indiens (Le sorcier du Rio Grande, Arrowhead, Charles-Marquis Warren, 1953), de tête brûlées (Attaque, Attack, Robert Aldrich, 1956) ou de Mongols (Les Mongols, I mongoli, André de Toth, Leopoldo Savona, Riccardo Freda, 1961).
C’est Robert Aldrich qui lui donne d’autres rôles : l’acteur hagard et survolté dans Le Grand Couteau (The big knife, 1955), d’après une pièce de Clifford Odets (1955), le lieutenant intègre et désespéré dans Attaque ! (Attack, 1956).
Il débuta sa carrière européenne dans Austerlitz (Abel Gance, 1960) et joua, en 1963, Jeremiah Prokosch, un producteur américain brutal et cynique dans Le mépris (Jean-Luc Godard, 1963 qui évoquait « son visage d’oiseau de proie asiatique [qui] s’est légèrement amolli. »).
Après une longue parenthèse, Jack Palance reparut en peintre excentrique dans Bagdad Café (Bagdad Cafe, Percy Adlon, 1987), comédie allemande située aux Etats-Unis qui connaît un succès étonnant. Deux ans plus tard, Tim Burton lui donne le rôle du père du Joker dans Batman (1989). En 1990, il est devenu un homme de l’Ouest parodique dans La vie, l’amour … les vaches (City Slickers, Ron Underwood, Billy Cristal, 1991) où il gagna l’oscar du meilleur second rôle et accomplit ainsi son souhait de réussir dans une comédie.
Palance apparaît ici comme un séducteur crédible, cultivé et raffiné, rôle peu commun vu la carrière de l’acteur conditionnée par son physique, pour devenir un gigolo.
A noter Touch Connors, qui ne se nomme pas encore Mike Connors, celui qui deviendra plus tard, ce n’est pas une marque de capotes, pour la télé le célèbre Mannix (1967).
Gloria
Gloria Grahame incarne un de ses innombrables rôles de femme fatale. Une sacrée garce ! Tout est dans le regard. Une grande actrice. Elle est plus imparfaite physiquement, presque banale car identifiable par rien, plus vulnérable, insiste Gleize qui la préfère largement. Elle crève l’écran, celle qui joua dans Sous le plus grand chapiteau du monde (The greatest show on earth , Cecil B. DeMille, 1952), Les ensorcelés (The bad and the beautiful, Vincente Minelli, 1952), Règlement de compte (The big heat, Fritz Lang, 1953). Elle était mariée au metteur en scène Nicholas Ray, puis à son beau-fils. Elle a eu deux oscars.
Dans une de ses premières critiques, François Truffaut soulignera, pour une fois de façon pertinente : « Pas un plan dans ce film qui ne soit nécessaire à la progression dramatique. Pas un plan non plus qui ne soit passionnant et ne nous donne à penser qu’il est le clou du film. […] Un scénario ingénieux et d’une belle rigueur, une mise en scène davantage qu’honorable, le visage de Gloria Grahame et cette rue de Frisco dont la pente est si rude, prestiges d’un cinéma qui nous prouve chaque semaine qu’il est le plus grand du monde. » (Cahiers du cinéma n° 21, mars 1953). Le film commence comme une comédie dramatique traditionnelle avec un portrait de Myra.
L’Hollywood classique en son âge d’or offre une galerie de femmes instables mais séduisantes, qui veulent toutes échapper au carcan d’un monde d’hommes, mais n’y arrivent jamais, piégées par leurs doutes et leurs névroses (Secret de femme, A Woman’s secret, 1949, Le Violent, In a lonely place, 1950 de Nicholas Ray ; Règlement de comptes, The big heat, 1953, Désirs humains, Human desire, 1954, Fritz Lang ; Alibi meurtrier, Naked alibi, Jerry Hooper, 1954 ; Le Coup de l’escalier, Odds against tomorrow, Robert Wise, 1959).
Les qualités
Le scénario, plein de rebondissements, écrit par Lenore J. Coffee et Robert Smith, d’après le roman Ils ne m’auront pas (Sudden Fear) d’Edna Sherry, déroule une structure classique en trois actes : l’amour, la méprise, le châtiment. Quelques sommets approchent le suspense hitchcockien avec l’utilisation du hors champ, la séquence notamment de l’emploi du temps qui prépare le spectateur à une version forcément moins fluide des faits à cause du nécessaire grain de sable. Respiration suspendue lorsque le chat, évidemment noir, risque de révéler la présence de Myra, planquée à côté. J’ai éprouvé une peur semblable à celle ressentie lors de la projection de Raccrochez c’est une erreur, Sorry wrong number, Anatole Litvak, 1948 avec l’excellente Barbara Stanwyck et le sourire carnassier de Burt Lancaster, film projeté dans la très prisée section Art of noir avec Eddie Muller de Frisco et Phil Garnier lors du Festival Lumière 2013).
Charles Lang (Les 7 Mercenaires, The magnificent seven, John Sturges, 1960), ainsi que Loyal Griggs, directeur non crédité de la seconde équipe, magnifie le film grâce à sa photographie impeccable notamment pour les éclairages d’intérieurs et pour les magnifiques scènes nocturnes de course folle de la seconde partie du film dans un Frisco offrant ses vues panoramiques et ses perspectives naturelles. Des plans sont répétés où l’aiguille de l’horloge se balance sur le visage entre les deux, ce que les surréalistes, comme Man Ray, ne renieraient point.
Un autre film avec Bette Davis traite des desseins criminels d’une romancière, Jezebel (Another man’s poison, Irving Rapper, 1951).