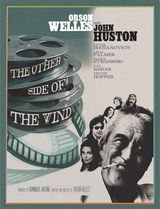« du visible dans le non-vu, de l’audible dans le non-entendu, du compréhensible dans l’incompris, de l’aimable dans le non-aimé. » (Jean Epstein, Le Cinéma du Diable).
Jean-Hulk a gobé des rayons gamma. Longtemps que j’ai décroché de Godard. Trainé des pieds. Et là, la claque, la commotion. C’est l’un des grands films de cette année, n’en déplaise aux dernières déclarations d’Eddy Mitchell / Moine. Je dirais même plus : nous ne sortons pas dans le même état que dans lequel nous sommes entrés, cela se nomme art. Comme une évidence en temps d’urgences. Limpide.
Le livre d’image sera peu diffusé en salle (« les images doivent passer sur une toile réservée à la peinture ») car l’œuvre se positionne entre l’installation d’art contemporain et poésie, au sens étymologique de faire (poiesis), visuelle et sonore (voire électroacoustique avec son choral dispersé en 7.1, une sorte d’Ecrits/studio réussi, il n’y a pas de mal) avec des moyens artisanaux (un écran plasma sur lequel Aragno, l’un des collaborateurs comme monteur, filmeur et producteur, « Ou des fois je lui laisse faire, je lui dis : « Faites à votre idée », et puis ça me donne d’autres idées. Ou bien on garde et puis, disons, il régularise la chose pour la livraison. Au tournage, il fait aussi bien le son que l’image comme quelqu’un en documentaire. » selon JLG, précise qu’« Aujourd’hui, sur les téléviseurs 8K, le contraste entre le noir et le blanc est de 10 000, alors qu’en salle, on arrive à peine à 2000. Le livre d’image a été fabriqué sur un grand écran plat, avec 10 000 de contraste. Projeté sur un écran blanc, le noir n’est jamais noir. C’est de la non-lumière sur du blanc, toujours un peu grisâtre. Tandis que sur un écran plat, LED ou plasma, c’est noir noir. Un gouffre. », et deux hauts parleurs éloignés pour que le son soit découplé au maximum de l’image puisque « Le but était de séparer le son des images, qu’il ne soit pas le compagnon de l’image mais qu’il la commande. Les frères Lumière qui n’avaient pas le son, à leurs débuts, étaient des contemporains des impressionnistes, ils ont utilisé les couleurs » – le projet initial était un film-sculpture pour trois écrans, ce qui a déjà existé avec Napoléon d’Abel Gance, 1927, en cours de restauration, que j’ai eu la chance de voir dans le dispositif original dans les arènes de Nîmes). La projection se déroulera dans des théâtres (comme le Vidy à Lausanne du 16 au 30 novembre), au Centre Pompidou, à la Galerie nationale de Singapour, au musée Reina Sofia à Madrid et dans un musée new-yorkais. D’où le privilège de l’avoir vu – Claire Denis était également dans la salle -, à l’Institut Lumière (Lyon), là où le cinéma est né (3 versions de La Sortie des usines Lumière, 1895), précisément.
*
Le sous-titre du film est : Image et parole (« Parce que les Américains et les Allemands, ils n’ont pas de mot pour ‘parole’. Ils disent ‘Worte’ ou ‘words’. Même Hamlet dit : « Words, words, words. » Mais il n’y a pas de mot pour ‘parole’ »). C’était le titre initial du film, avec papyrus entre parenthèses. Il s’agit, dans la lignée de ses Histoire(s) du cinéma (1989, 1999, 2005) – aporie esthétique annonçant les plus classiques Scorsese (Un voyage avec Martin Scorsese à travers le cinéma américain, A personal journey with Martin Scorsese through american movies, 1995 ainsi que Mon voyage en Italie, My voyage to Italy, Il mio viaggio in Italia, 1999), Frears (A personal history of British cinema by Stephen Frears, 1995) et Tavernier (Voyage à travers le cinéma français, 2016, 2017) -, d’un travail de collage (images d’actualité, archives, extraits de films en HD, morceaux d’œuvres, transformées ou non, fragments textuels ou musicaux, surimpression et surexposition des images, titres, surtitres, intertitres), comme chez Schwitters, Heartfield, Ernst ou de montage (par exemple, des victimes de Daech sont jetées à l’eau d’où James Stewart sauve Kim Novak dans Sueurs froides, Vertigo, Hitchcock, 1958; un monstre de Freaks de Tod Browning, 1932, se retourne confus devant une image porno – montage facile mais efficace) plus que de tournage.
Jeux de main
L’expérience est en cinq parties, comme les cinq doigts de la main – « Et – enfin ! – ma main vit, ma main voit. »; la geste étant omniprésente comme dans l’art religieux et l’histoire de l’art en général -, mais le dernier doigt, selon Godard, est aussi le centre, la partie centrale de la main :
1- « Remakes » (constat de l’invariable répétition des guerres, qualifiées de « divines » en tant que constante de la nature humaine, et des catastrophes au cours de l’histoire, en confrontant les conflits d’antan avec ceux d’aujourd’hui ; toute civilisation est fondée sur un génocide, « C’est une brève histoire que celle de l’extinction en masse des espèces » ; Remakes rime avec rimes, à condition de le scinder en Rime(ake)s; remake, c’est aussi la copie),
2- « les Soirées de Saint-Pétersbourg » (la superbe plume du philosophe savoyard contre-révolutionnaire et ultramontain, ambassadeur de Napoléon en Sardaigne, Joseph de Maistre – choix étrange pour un Godard de gauche bien que son portefeuille soit à droite, à la place du cœur – dont l’ermite de Rolle aurait pu choisir l’ouvrage du frère Xavier, Voyage autour de ma chambre, 1794),
3- « Ces Fleurs entre les rails, dans le vent confus des voyages » (sur ces vers de Rilke, nombre d’extraits de films apportés par la chercheuse Nicole Brenez où le train – « Сomme si c’était un train, le cinéma était la locomotive et la politique, tout ça, était le dernier wagon », déjà présent dans la catastrophique exposition Voyage(s) en utopie, à la recherche d’un théorème perdu à Pompidou en 2006, cause de fâcherie provisoire avec Païni, objet de Reportage amateur, ersatz du projet initial Collage(s) de France, archéologie du cinéma, d’après JLG laissé en chantier, maquettes comprises -, est présent dès L’arrivée du train en gare de La Ciotat, frères Lumière, 1896, reflet du procédé cinématographique avec le travelling et sa dite morale, évoque, comme dans Le mécano de la Générale, The General, de Keaton, 1926, les mouvements conjoints de l’histoire, dont les camps de la mort ou l’exode dans Manon de Clouzeau, 1949, d’après le roman de l’abbé Prévost, et des images),
4- « l’Esprit des lois » (Henry Fonda incarnant le jeune Lincoln dans Vers sa destinée, Young Mr Lincoln, J. Ford, 1939, avant celui, jouant un homme enfermé à tort, du Faux coupable, The Wrong Man, Hitchcock, 1956 ; la politique où la justice passe avant la loi ; le cadre d’après Montesquieu dans une société actuelle où la notion de contrat des Lumières tend à être obsolète sans modèle alternatif viable; une chanson de Vissotski évoquant les règles et le dépassement des règles pour survivre),
5- « la Région centrale » (titre emprunté à Michael Snow, 1971; un Touareg caresse délicatement le menton d’une innocente gazelle comme dans une aquarelle ou une peinture de Delacroix ; allusion à l’Arabie heureuse d’Alexandre Dumas, le Moyen-Orient fantasmé par Godard sur le fondement du chemin de fer en Turquie de Smyrne, construit par son grand-père maternel, à un petit endroit qui s’appelait Cassaba, nom de son premier chien, par l’occident avec Salammbô de Flaubert avec tournage à la Marsa, sur l’ancienne Mégara, et l’inévitable Shéhérazade des Mille et une nuits, Saint Louis, mort à Carthage; Jeancul God cause des religions du livre, « les hommes vénèrent beaucoup trop les textes, la Bible, le Coran, la Torah », et du rapport à la guerre; l’actrice Ghalia Lacroix, qui joue en Tunisie, pays où plusieurs plans ont été tournés par Aragno, le rôle de Djamila dans For Ever Mozart, 1996 – où il était question déjà d’« une saturation de signes magnifiques qui baignent dans la lumière de leur absence d’explication » selon Manoel de Oliveira en 1993 -, et qui apparaît à plusieurs reprises, sans oublier Beyrouth et la Jordanie pour Ici et ailleurs, 1976 réalisé avec Jean-Pierre Gorin ; bref, un long chapitre, naïf sur le plan géopolitique – Bruno Etienne où es-tu ? Kepel sera ton disciple -, son Automne à Pékin sur le Moyen-Orient sentimental et sa satellisation par le reste du monde, où revient la question lancinante « Les Arabes peuvent-ils parler ? » avec l’occident qui ne comprend rien telle Bécassine car « les arabes et les musulmans n’intéressent personne », sont-ils audibles par des personnes sachant les écouter voire les entendre ?, à travers plusieurs extraits, lus par lui, du roman Une ambition dans le désert, 1984, Dofa, la « misérable oasis de Dofa » où régnait une paix souveraine, « car là où il n’y a rien, même les scélérats se résignent à l’indigence » alors que le premier ministre, Ben Kadem, dirige – car chacun se rêve actuellement roi mais personne ne se rêve Faust – tout en organisant de faux attentats révolutionnaires dans son propre État pour attirer l’attention des grandes puissances car privé de ressources pétrolières, bien que son sage cousin, Samandar, déplore que les bombes pleuvent, de l’écrivain égyptien francophone Albert Cossery habitant à l’hôtel Louisiane à Saint-Germain; Hasards de l’Arabie heureuse, titre en français dans le texte, de l’américain Frederic Prokosch; l’extrait du philologue palestino-américain Edward Said, Dans l’ombre de l’Occident, offre un apport critique : « la représentation, plus précisément l’acte de représenter (et donc de réduire) implique presque toujours une violence envers le sujet de la représentation; il y a un réel contraste entre la violence de l’acte de représenter et le calme intérieur de la représentation elle-même, l’image (verbale, visuelle ou autre) du sujet. » – Marie-José Mondzain aurait à disserter sur le sujet, le statut de l’image ; finalement, la région centrale, c’est l’amour, présent par exemple avec un couple tragique dans La Terre, Zemlya, de Dovjenko, 1930).
5 comme les cinq doigts de la main – reçue 5 sur 5 -, par quoi l’homme pense, accomplissant sa véritable condition dans cet Essai à la Montaigne : « La vraie condition de l’homme, c’est de penser avec ses mains » selon Rougemont cité ; « Avec ce film, je me suis intéressé aux faits, à ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. J’espère que mon film montre ce qui ne se fait pas. Il faut parfois penser avec les mains et non la tête ». Leroi-Gourhan, l’homo faber de Bergson. Godard fait main basse : « Par exemple tendre la main au dehors et rassembler en un faisceau, du simple geste de la refermer, les voix qui passent du monde. Un simple geste de la main. » comme l’écrit Cholodenko.
« Un crime derrière chaque mot ! » écrit Novarina dans Le drame de la langue française dans Le théâtre des paroles. Godard fait un doigt avec son contestable « Que des gens lancent des bombes, ça me paraît normal, que faire d’autre ? Je serai toujours du côté des bombes… » compréhensible d’un certain sens mais quid du Bataclan et ailleurs ?
Godard aime le côté artisanal de la collure au montage (« Vous savez, moi je ne suis qu’un fabricant de films ») : il utilise le montage analogique avec de vieux appareils, 7 ou 8 machines qui remplissent la pièce datant d’il y a 10, 15 ans, dont l’un ne permet pas de revenir en arrière – aucune erreur possible. Constatant, de façon réaliste et logique, que nous sommes en guerre (« On n’est jamais suffisamment triste pour que le monde soit meilleur » Elias Canetti, clamait à Cannes sa productrice Mitra Farahani, Ecran noir; « La guerre est là…», nous annonce Yoda avec une faible et vieille voix tremblotante au souffle coupé par trop de cigares ; « tout ce qui vit doit être immolé sans relâche »), le sujet proposé par Godard est l’histoire des images et leur utilisation pour comprendre les régimes autoritaires (l’image arrêtée de l’armée israélienne suivie d’un plan du Cercle de la merde dans Salo ou les 120 journées de Sodome, Salò o le 120 giornate di Sodoma, Pasolini, 1975; dans le film de Rossellini, on les voyait jeter à la mer, pour signifier la fin de la guerre, et puis après dans le film islamiste on les voit rejeter à la mer), le fascisme, l’obscurantisme (les islamistes dans Timbuktu de Sissako, 2014), la mythologie et l’art.
Au début est le noir. Et la lumière fut. Faisant fi des Schtroumfs, Godard invoque Bécassine : « Les maîtres du monde devraient se méfier de Bécassine parce qu’elle se tait ». « Ce dont on ne peut parler, il faut le taire » concluait Wittgenstein dans son Tractatus Logico-Philosophicus écrit dans les tranchées. Antépénultième : « Même si rien ne devait être comme nous l’avions espéré, ça ne changerait rien à nos espérances » Peter Weiss. La fin : l’association (samples et boucles, surimpressions et monologues, cut-up), principe essentiel du dispositif godardien agrémenté de la translation comme chez Proust inspiré de Ruskin ou Claude Simon qui faillit être peintre, de la « révolution » (« Il doit y avoir une révolution. ») et de l’image finale d’une chute. Le dernier plan, emprunté à Le plaisir (Ophuls, 1952), c’est un couple de la Belle Epoque exécutant la danse du Masque de façon survoltée ; l’homme, un dandy sans visage, bouge comme un pantin, s’écroule d’un coup, raide mort, disparaît du champ ; sa cavalière poursuit sa danse, puis recouvre ses esprits, se retourne – on achève bien les chevaux. Les derniers mots : « ardent espoir ».
Le monde est bleu comme un orage
Les portraits défilent : Rimbaud, trafiquant aux semelles de vent arrivé à Aden, puisque le film est sous le sceau de Les Illuminations où le livre d’image serait, en une fausse piste, parsemé d’enluminures et de fulgurances guidées par de puissantes intuitions qui mériteraient parfois d’être développées, Céline, « Faites passer sur nos esprits, tendus comme une toile, vos souvenirs avec leurs cadres d’horizons. » (Voyage, Baudelaire), ralenti sur Jean Gabin, un fond de Scott Walker, l’un des modèles de Bowie qui contribua à faire connaître Brel dans le monde anglo-saxon, le C. F. Ramuz de l’enfance, écrivain si oublié et pourtant si contemporain avec ses répétitions hypnotiques, un plan sur Cocteau foudroyé avec l’emphase que nous lui connaissons, Caillebotte, Eddie Constantine (souvenons-nous d’Alphaville, 1965), Depardieu, Odile Versois, Rosa Luxembourg très présente, Gauguin, sa compagne Miéville avec le plan sur son livre, préfacé par Jean-Luc, Images en parole où un extrait poétique est lu, etc. Au gré, sont reconnaissables, comme des restes archéologiques, Le dernier des hommes (Der letzte Mann, Murnau, 1924), le fameux œil tranché, ou métaphore du cinéma qui nous plonge dans une scène d’horreur qui marque comme aux débuts du cinéma, du Chien andalou (Luis Buñuel, 1929 avec Salvador Dalí), le père Jules (Michel Simon) et, dans un autre extrait, la jeune mariée (Dita Parlo) dans L’Atalante (J. Vigo, 1934), Berry en diable dans Les Visiteurs du soir (M. Carné, 1942), le kitsch Johnny Guitar (Nicholas Ray, 1954), La strada (Fellini, 1954), En quatrième vitesse (Kiss Me Deadly, R. Aldrich, 1955), Alenka (Alyonka, Barnet, 1962), Hamlet (Franco Zeffirelli, 1990), Elephant (Gus van Sant, 2003), etc. ; il ne s’oublie pas avec des extraits du Le Petit Soldat et Les Carabiniers (1963), de Week-end et La Chinoise (1967) et d’Hélas pour moi (1993). Si aucun droit n’est demandé aux auteurs, le tout figure dans un générique digéré dans le film, comme dans le catalogue dada.
Outre le train, le symbole le plus parfait du cinématographe est cet extrait de Mouchette (Bresson, 1967, d’après un roman de Bernanos), mais aussi bien dans La règle du jeu (le marivaudage de Renoir, 1939), parfois mis en ralenti par Godard, de ce lapin chassé, entre vie et mort, présent et futur débouchant sur le passé, où Mouchette projette son destin malheureux. C’est sa flèche de Zénon. Ici compte le mouvement, le contrepoint (« le contrepoint est une discipline de la superposition des mélodies », dans une perspective où les arrangements prévalent sur l’harmonie et la différence des mélodies sur leur parenté), l’ascétisme (Godard retire, élague, d’où son équation, omettant pourtant un nombre imaginaire dans sa conférence de presse cannoise en FaceTime sur un téléphone portable où les journaleux défilent un à un : « Un film c’est plutôt une équation que peut résoudre un enfant. C’est X+3=1. Si X plus 3 égale 1, alors X égale à -2. Autrement dit, quand on fait un film, pour pouvoir trouver une image, il faut en supprimer deux. C’est la clef du cinéma. Mais si c’est la clef, il ne faut pas oublier la serrure », c’est-à-dire l’image), le rapport entre les plans par le montage avec un effet Koulechov décuplé. Godard retire comme les affiches lacérées de Hains : aller à l’os. Gilles Jacob a raison de qualifier Godard de « Picasso du cinéma », sachant qu’ayant dépassé sa période bleue, il revient à cette couleur.
« Nous nous demandions comment dans l’obscurité totale / Peuvent surgir en nous des couleurs d’une telle intensité ». Le livre d’image a failli s’intituler Tentative de bleu ou Le grand tableau (noir). Nous plongeons dans le bleu, couleur primaire (cyan), comme dans une installation de James Turrell (exposition La beauté, Avignon, 2000), en évitant le bleu Klein, l’océan, la méditerranée, les qualifiés de migrants ou réfugiés sur des Radeau de la méduse, Lesbos, la poésie, Ulysse (Le mépris, 1963). Godard choisit des extraits et les triture avec un appareil spécifique qui amplifie le signal : les aplats de zones saturées à dominante bleue, l’étalonnage en bleu laissent songer nettement à Nicolas de Staël qui était exposé à Voyage(s) en utopie, à la recherche d’un théorème perdu (le tableau Les musiciens, souvenir de Sidney Bechet, 1953 mais également La Blouse roumaine d’Henri Matisse, avril 1940). Loin de Van Gogh, dominé par le bleu, de Pialat (1991), anciennement peintre, JLG utilise des couleurs, un noir et blanc triturés, parfois sursaturés, solarisés, pixellisés, jusqu’à la dégradation volontaire (le bal dans Guerre et paix, Voyna i mir, Sergey Bondarchuk, 1966 d’après Tolstoï en souvenir de l’invasion allemande en Russie ; l’érudit Eisenschitz fournit en films russes). Aragno remonte et retravaille sur ordinateur (HD, 3D) afin de rechercher une définition meilleure, éviter les problèmes de trame. L’apport numérique révèle la matière, vivante, organique, argentique du cinéma par le grain de l’image, les perforations de la pellicule. Le résultat : l’expressionnisme numérique.
Le changement de format en cours de projection (4/3, 16/9 : « Je veux dire qu’autrefois les peintres, ils peignaient avec ce qu’ils avaient à disposition. Quand on a inventé les tubes de peinture, ça a beaucoup changé, l’impressionnisme etc. Donc, on fait rien que le réel. (…) Même la télé : il n’y a pas un téléviseur qui fasse pareil que l’autre. Donc, on n’y peut rien. Il faut tâcher qu’il reste une chose et c’est cette chose qu’on doit choisir au départ et chercher, si vous voulez. »), de cadre, en jouant sur la télécommande, comme ce qui est possible de faire avec la tv, n’est pas maîtrisé et pas heureux. Le texte comme valeur cardinale justifie le titre Le livre d’image où les mots à l’écran sont comme des images : « Avec les religions du livre, le texte des lois, les Dix Commandements, nous avons sacralisé le texte. Il fallait le livre d’image. ». La qualité de Godard est sa capacité à recevoir. JLG réinvente le visuel en réaffirmant que la langue ne sera jamais le langage.
Le son du chaos du monde
« On a perdu un peu la sensation d’espace, beaucoup même, qu’il y avait dans les premiers films avant la Deuxième Guerre mondiale. Tout est devenu plus à plat, si vous voulez, et très différent de la peinture. Une bonne photo à un moment parle mieux qu’une image. Même les travellings : je me souviens de la phrase de Cocteau qui disait que faire un travelling était complètement idiot parce que ça rendait l’image immobile. » « Pendant quatre ans, j’ai cherché à trouver quelque chose, certains sons qui pourraient raconter quelque chose. Parce qu’il faut quand même raconter quelque chose ! Je pense que le texte peut s’accrocher aux images ». Et encore : « la recherche d’un son qui est l’équivalent d’une image et qui est plus près de la parole au sens profond ». Si Adieu au langage (2014) explorait la 3D en image, ici le 3D est sculpté par le travail sonore spatialisé. Son tournoyant et décalé pour les voix off du réalisateur, on dirait une production de l’INA/GRM mais il s’agit d’une élaboration là aussi artisanale : pression acoustique, baffle Jbl des années 80 avec une belle rondeur dans le son, nul max msp. Si les 3 panneaux centraux de l’écran sont utilisés comme d’habitude, les panneaux latéraux sont mis à contribution, non pour un dolby ou autre, pour un effet sidérant, immersif et saisissant, même si la voix de Godard est parfois inaudible, à cause d’un mauvais dosage, au point de se reporter aux sous-titres en anglais auxquels Godard avait d’abord renoncés car en « américain ». Le découplage image/parole, notamment pour les bombes et les explosions, est justifié contre « le son [qui] va avec l’image et qu’on croit ce qu’on voit ».
*
Si Artaud prônait un séminal théâtre de la cruauté, Godard révèle ici un cinéma de la cruauté : être une pensée par l’image et une image de la pensée dans le chaos du monde. Inspirant.
Pour ces 50 ans de mai 68, où l’affiche de Cannes piochait dans Fierrot le pou (1965) où Bébel embrasse son ex Karina, une palme d’or spéciale a été créée. Cate Blanchett a salué « un artiste qui fait avancer le cinéma, qui a repoussé les limites, qui cherche sans arrêt à définir et redéfinir le cinéma ».