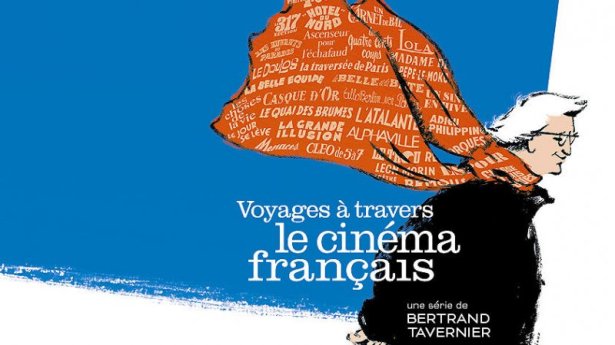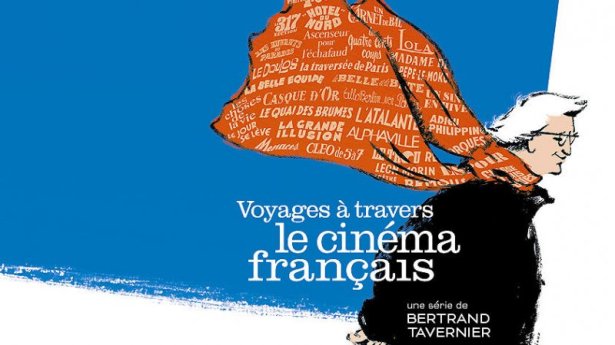
Tavernier affirmait les poings sur la table que s’il ne pouvait pas filmer les épisodes suivants, il s’exilerait. Les voici donc, même s’il aurait préféré en filmer 10 plutôt que 8, format infligé par France tv, et pas forcément diffusé à 23h30 à France 5 en même temps que Le cinéma de minuit, délaissant la possibilité du replay. Les génériques identiques des épisodes laissent songer justement à celui de Le cinéma de minuit : L’Atalante (J. Vigo, 1934) et la musique de Jaubert, jingle de feu Projection privée de Michel Ciment sur France culture, Panique (Duvivier, 1946) qui revient deux fois, l’inévitable et, selon moi, surestimé marivaudage La règle du jeu (Renoir, 1939), Casque d’or (1952) et Le trou (1960) de J. Becker, Ascenseur pour l’échafaud (L. Malle, 1958), Alphaville (Godard, 1965), un film non identifié avec Lino Ventura, un autre avec Arletty et Gabin.
L’aspect inattendu de ces épisodes est de nous montrer l’état physique qui se dégrade de Bertrand Tavernier. Ayant mangé du mouton avec sa tremblante, il sucre les fraises. Il reste passionné mais on sent que c’est son testament, ce qui est émouvant. C’est donc avant tout, de façon inattendue, un documentaire sur la mort au travail. Ah la voix d’André Marcon ! Les épisodes manquent d’ouverture sur l’extérieur, tant rares sont les images d’archives, la voix off de Marcon est irritante à la longue. Les extraits de l’émission de TMC, avec témoignages d’acteurs ou autres, ne sont pas du meilleur effet à cause de la piètre qualité VHS – ce qui fait un peu amateur -, mais il est vrai qu’Ollé-Laprune, présent dans cette émission, collabore ici avec Tavernier.
1 Mes maîtres : Grémillon, M. Ophuls, Decoin
Becker, Ophuls que je goûte peu. Becker est classique voire académique, la fameuse « qualité » française pour moi, au sens noble comme un bon artisan, mais a été un peu oublié. Bon faiseur comme Tavernier, dont il s’inspire puisque c’est le réalisateur du premier film qui l’a marqué (Dernier atout, 1942). S’il y a des choses intéressantes, le cinéma de Becker a globalement mal vieilli. Il devait être un bon directeur d’acteur, l’humaniste, car les comédiens sont extraordinaires. Les métiers sont saisis avec une concision journalistique mais conservent malheureusement cette teneur sans la transcender.
A part Madame de … (1953) que je trouve charmant et fluide, d’après un roman de Louise de Vilmorin laissant songer au collier de la reine chez Dumas père, avec une Danielle Darrieux et un de Sica extraordinaires, j’ai beaucoup de mal avec ses autres films, tous baroques, qui veulent en mettre plein la vue. Certes, les films sont bien tournés, construits, image et chef op’ impeccables, mais, je n’ai jamais su pourquoi, l’univers d’Ophuls, peut-être trop prétentieux et trop carton-pâte, me révulse, rien à faire. Un gros gâteau viennois dégoulinant de sucre. Il faut distinguer l’homme de l’œuvre, mais Ophuls était un sale type qui cognait femme et enfant. Dans ses films, le spectateur sent que le réalisateur, certes déraciné et ancré dans un univers, comme un Stroheim, bien plus inventif voire expérimental, est un être tourmenté. Par contre Tavernier mentionne ses films américains qui sont passionnants, notamment Pris au piège (Caught, 1949) avec J. Mason, aussi flippant, Barbara Bel Geddes, qui sera, après des épisodes d’Hitchcock presents, dans Sueurs froides (Vertigo, 1958) puis la matrone de Dallas, et Robert Ryan.
Grémillon est lyrique parfois jusqu’à la niaiserie. Si ce metteur en scène est attachant, il sent le suranné. Remorques (1941) est limite ennuyeux tant il est répétitif. Le ciel est à vous, mouais.
Decoin est un type incroyable : issu d’une famille pauvre, il devient champion olympique de natation puis devient journaliste – ce qui aura une forte influence sur ses scénarios. Puis il fut résistant et décoré en tant que tel. Reste que, peut-être par peur de retomber dans la pauvreté, il a beaucoup tourné et pas que des chefs-d’œuvre. Il était/est vu comme un cinéaste commercial. Se dégagent Les inconnus dans la maison (1942 avec une touche antisémite comme chez Simenon dont le film est tiré), l’incroyable Les amoureux sont seuls au monde (1948), une ode à sa femme séparée, l’actrice Danielle Darrieux très attachée, avec un air de musique accrocheur, objet d’intrigue, le très noir La vérité sur Bébé Donge (1952), d’après Simenon, où Gabin est en faiblesse, et donc en valeur, lors de longs des flash-backs, le classique Razzia sur la chnouf (1955) où le milieu de la drogue est décrit, presque sur un ton documentaire, dans sa dureté, une vingtaine d’année après Stupéfiants (K. Gerron, un acteur qui joua le magicien dans L’Ange bleu, Der blaue Engel, 1930, de Sternberg, aussi von que Trier, aux côté de Dietrich, 1932) et avant L’homme au bras d’or (The Man with the Golden Arm, O. Preminger, 1955) où Gabin n’a pas le beau rôle mais satisfaisant sa morale personnelle. A noter le peu réaliste De onze heures à minuit ( ) avec un dialogue de Jeanson qui fuse tant il fait flèche de tout bois, une délectation. Decoin, formidable directeur d’acteur et grande force physique, a touché tous les genres.
2 Pagnol-Guitry / Bresson-Tati
Les réalisateurs du verbe pour un amateur de théâtre, Tavernier. Guitry est un conteur. Faire de Guitry, le prédécesseur de Tarantino (la parlote qui domine, appuyé par le délirant Assayas, ancien des Cahiers du cinéma qui en compte tant, Douchet en première ligne, et son débit de mots insupportable : et pourquoi pas Nanni Moretti pendant que nous y sommes ?) et de la Nouvelle vague me fait littéralement bondir hors de mon siège tant c’est faux et incongru. Sacha qui se contemple en permanence, toujours content de lui, égratigne les femmes de façon mesquine. Sacha, avec sa ridicule voix nasale et son pédantisme, finit par nous faire rire avec ses dialogues au cordeau. Avec sa clique artistique héritée de son père, au fond Guitry poursuit le travail des Lumière en sauvegardant la mémoire d’une époque révolue (Monet aveugle, Renoir aux mains déformées, etc.).
A part quelques films de Pagnol trop ignorés, rien de neuf sous le soleil marseillais. Faire de Pagnol un moderne prête au ridicule. Il était un bon dialoguiste, un bon directeur d’acteur mais c’est tout. Regain doit tout au texte de Giono où l’insupportable Fernandel paraît incongru. Un bon dialogue ne suffit pas à faire un bon film.
Tavernier était impressionné par Bresson qui faisait tout pour, jusqu’à la caricature. Ce qui est dit sur Bresson est assez juste mais souligner qu’il se déroule autant d’évènements dans Au hasard Balthazar (1966) que chez Tarantino (« On est frappé par le nombre de péripéties que contient le scénario. On est quasiment devant un film de Tarantino. Le contraste entre le nombre des péripéties et la manière dont Bresson les filme, donne un ton extraordinaire et souvent bouleversant ») est d’une grande débilité de cinéphile aveuglé par sa passion (pourquoi pas Lancelot du lac avec un début et une fin gore qui confine au nanar d’horreur ?) qui donne des références parlantes pour le spectateur actuel. A propos de Un condamné à mort s’est échappé (Le vent souffle où il veut, 1956 ; « Œuvre limpide et mystérieuse, équilibrant l’expérimental et le cinéma traditionnel »), tourné à Lyon, aucune référence à Le trou (1960) de J. Becker, film radical à la magnifique beauté plastique où Jeannot a été piocher chez Robert, qu’apprécie pourtant Tavernier puisqu’il en cause dans un autre épisode. Le témoignage de Casarès (Les dames du bois de Boulogne, 1944, d’après Jacques la Fataliste de Diderot lui-même inspiré de Laurence Sterne), actrice au jeu éculé et emphatique se complaisant dans la tragédie mélodramatique, est sans complaisance mais indique les exigences de Bresson qui affirme, dans un entretien, être solitaire sans aimer cela. Bresson, c’est un peu le Thelonious Monk du ciné : ça sonne faux. Ce qui compte, c’est le montage (Eisenstein, Koulechov) et les rapports entre les plans qui marquent. Rien sur le Diable, probablement (1976), titre magnifique et durassien pour un film revendicatif et écologique, pas plus sur L’argent (1977). Bresson n’a pourtant tourné … que 13 films !
Le parallèle avec Tati, pourquoi pas sur la radicalité, le rejet de la modernité et ses appareils, le travail du son et la post synchronisation, mais enfin un pascalien ennuyeux et un comique, si triste au fond, venu du music-hall et de la pantomime n’ont que peu de rapport, eu égard à l’absence de comique chez Bresson. Les approches sont radicalement différentes. Etonnamment, alors que la musique, bien sous-estimée en général, envahit littéralement le propos ad nauseam (vente du cd de musique de film en produit dérivé ?) dans chacun des épisodes de Tavernier, aucune mention n’est faite de la musique de Francis Lemarque, primordiale, chez Tati (nostalgie de l’enfance, manège, etc.). Il n’est pas possible de tout dire en si peu de temps mais omettre qu’Etaix, qui figure dans Pickpocket (R. Bresson, 1959) était l’assistant de Tati, c’est un peu gros. Plus intéressant que de pointer Balkany comme danseur dans Playtime (J. Tati, 1967) en tout cas. Dire du compositeur J.-J. Grünenwald (chez J. Becker avec Falbalas, 1945, Antoine et Antoinette, J. Becker, 1947, Édouard et Caroline, 1951 ; chez Bresson avec une fabuleuse partition dans Les anges du péché, 1943 aussi forte que J. Williams dans Seconds, J. Frankenheimer, 1966 ; je n’apprends rien sauf que pour qualifier les œuvres de Giraudoux, il faut dire giralducien – bon pour le scrabble ; Les dames du Bois de Boulogne, 1945, Journal d’un curé de campagne, 1951 entre autres) que, alors que c’était un organiste amateur de Bach, c’est le prédécesseur de Phil Glass (La vérité sur Bébé Donge, H. Decoin, 1952), c’est d’une erreur et d’un anachronisme, concernant l’histoire de la musique, énormes; rien à voir avec la choucroute des répétitifs américains.
3 Les chansons / Duvivier
Sur la chanson, l’approche, vendeuse, est intéressante. A se demander si l’un des commanditaires n’est pas la Sacem. Enfin, enquêter sur un réalisateur à partir d’une chanson qu’il (co-)écrit est original même si biaisé. Mais il oublie que nombre de nanars des années 30 et après comportent des chansons. Aller hop le Ducreux d’Un dimanche à la campagne (1984), mon film préféré à partir d’autochromes Lumière du cinéaste de deuxième zone Tavernier, et pour cause vus ses cinéastes de chevet, d’après un roman à écriture blanche – mais pas avec la voix off idem comme chez Bresson, pitié ! -, de l’un de ses scénaristes après Autant-Lara, Bost. Si la comédie musicale française a été abondante dans les années 30-40, elle est devenue de plus en plus rare. Je ne supporte pas le kitsch Demy et encore moins Michel Legrand, rien à faire. La transition est habile avec chant et Duvivier.
Seul un borgne s’est tardivement rendu compte que J. Duvivier était l’un des plus grands metteurs français. Si Tavernier a la grandeur de reconnaître ses erreurs, il démontre, bien qu’il le dénonce, le parti-pris au sein de chapelles cinéphilique (les macmahoniens du Nikelodéon / Positif vs Cahiers du cinéma – querelle intellectuelle âpre bien française qui ne lasse point d’étonner les étrangers). Il fallait vraiment avoir une poutre dans l’œil, Gabin ne s’y était pas trompé, lui. Pessimiste, je veux bien mais n’a-t-il pas tourné, entre autres, Don Camillo (1951), l’excellent et réjouissant La fête à Henriette (1952) avec ses mises en abyme ? Dire que Duvivier se moque de lui-même dans le dernier film cité en référence à Un carnet de bal (1937), le sketch en angles hollandais expressionnistes avec le grand acteur Pierre Blanchar, est une grave erreur d’interprétation. David Golder (1931) est raté tant il sent encore les débuts du parlant malgré Harry Baur qui porte le film sur ses épaules et un scénario bien ficelé à partir du roman assez autobiographique d’Irène Némirovsky. Grande envie de voir Le paquebot Tenacity (1934) qui a déjà été conseillé à l’Institut Lumière. Plaisir de voir des archives avec Duvivier, un homme rare et timide, présenté comme sec : il est dans ses œuvres, pourquoi s’expliquer ? Divers témoignages de Spaak sont de première main. Tavernier tente de le rendre humain, ce qui est évident. Homme du Nord, il était simplement pudique. Tavernier tente de le comprendre par le biais de Ford, mouais. Le corps de Duvivier était usé par son travail de metteur en scène. Il est important de souligner l’effort physique que réclame le métier de metteur en scène. S’il a trop tourné, par peur de perdre la main, il n’en reste pas moins qu’il est l’un des plus grands réalisateurs français – d’ailleurs, c’est le seul qui occupe toute une demi partie d’un épisode tant il a tourné des films divers.
4 Les cinéastes étrangers dans la France d’avant-guerre / Le cinéma sous l’Occupation / L’après-guerre
Première vague avec les russes fuyant la révolution de 1917. Tourjansky est un cinéaste mineur, il n’est qu’à voir Volga en flammes (1934). Je ne savais pas qu’il avait tourné un film désormais perdu, Nostalgie mais est-ce vraiment une perte ? La Peur (Vertige d’un soir, 1936 malgré Gaby Morlay, Charles Vanel, Ginette Leclerc et Suzy Prim, Thirard en chef op’ et Piménoff au décor ; un pataud Kessel et un Feydeau au dialogue), film aux multiples tons d’après une nouvelle du Musso de l’époque, S. Zweig, qui a été mal tourné ensuite par Rossellini, le dernier et si raté avec Bergman (Non credo più all’amore (La paura), 1954, malgré Amidei au scenar et Kinski, est un sous Hitch plat avec poncifs sur l’Allemagne restauré par Immagine Ritrovata de Bologna, projeté lors du Festival Lumière 2014 en présence d’Isabella Rosselini : « Jamais film ne fut moins fignolé que celui-ci, exécuté en moins de trente jours par un cinéaste nerveux, incisif, charnel, impatient et soucieux de capter la vie à sa source, la juste expression d’une actrice à la première prise d’un plan et qui envie au cinéma d’actualités et de reportage sa spontanéité vraie et sa fulgurante vérité. », François Truffaut, Arts n°576, 11-17 juillet 1956) avec une chanson de Maurice Chevalier – aucune allusion à son comportement pendant la guerre, au regard de Trenet par exemple -, est rédhibitoire (« mélodrame fiévreux » selon Tavernier alors que c’est une daube ?). « Je te déteste, Je te déteste, Je te déteste » de Gaby Morlay qui annoncerait « Je ne t’aime pas, Je ne t’aime pas, Je ne t’aime pas » de Madame de … / Darrieux (Ophuls, 1953), bien que le contexte soit différent, pourquoi pas. Le dernier long-métrage de Tourjanski avant son retour en Allemagne, Le mensonge de Nina Petrovna (1937), remake du muet de Hanns Schwarz (Die wunderbare Lüge der Nina Petrowna, 1929, UFA d’après l’oeuvre de Hans Székely) semble meilleur, grâce notamment à Jeanson au dialogue ainsi qu’Isa Miranda, Fernand Gravey, Paulette Dubost et la toujours excellente Dorziat. Rien sur l’immense acteur Ivan Mosjoukine, qui a tourné d’ailleurs avec Tourjansky (Michel Strogoff, 1926 d’après Jules Verne, évidemment) ou d’autres réalisateurs comme Volkoff et Protazanov.
La deuxième vague fuit le nazisme, avec Eugen Schüfftan – qui a travaillé, tiens tiens, avec Ophuls -, Curt Curant, etc., rien sur l’exode due à la guerre en Espagne. Siodmack a effectivement réalisé au moins un chef d’œuvre, bien oublié : Mollenard (1938, Spaak, Schüfftan, Trauner), film noir du Front populaire avec Harry Baur, au personnage complexe, et la Dorziat, Préjean, le paniquard Dalio, Pierre Pitoëff, Pierre Renoir, Spaak au scénar au sommet de leur art. Le témoignage de l’ancien dirlo de la cinémathèque suisse, souvent présent au festival Lumière, dans le superbe jardin d’hiver de la Villa Lumière, est intéressant). Dans Pièges (1939 dont l’horrible et kitsch Sirk fit un remake Des filles disparaissent, Lured, 1947 avec la sexy Lucille Ball et le noir et cynique George Sanders, les trognes Charles Coburn et Boris Karloff), un film à sketch moyen style patchwork, les stars défilent (Marie Déa en Adrienne Charpentier, Mademoiselle Blanche, Gabrielle Deny, Adrienne Du Pont et Raymonde Blanchard ; Pierre Renoir, Erich von Stroheim) dont Maurice Chevalier qui s’essaye, plutôt bien, au rôle dramatique pour se donner une légitimité.
Rien sur Liliom (1934, un certain Fritz Lang, metteur en scène pourtant cité, d’après Ferenc Molnár, avec l’omniprésent Charles Boyer, un certain Artaud, Viviane Romance, un excellent second rôle Alcover, un petit rôle de Roquevert ; c’est un remake d’un film du pleurnichard et insupportable Borzage, 1930), c’est tout de même étrange car c’est un film emblématique de multiples reprises par des réalisateurs multiculturels qui parfois sont restés, même brièvement, en France. Marcel L’Herbier retoqué par Jeanson : « Il ne connaît qu’un seul patriotisme, celui du porte-feuille » cité goulûment par Tavernier fort amateur de pics. Savoir que Feyder, auteur d’un film pour le pavillon germanique de l’Expo universelle de 1937, a dénoncé d’autres metteurs en scène, fussent-ils étrangers en France, est terrassant (« ils mangent le pain des français » avec force manifs) – comme Autant-Lara, d’ailleurs ; mais ce dernier nous a habitué à pire.
L’occupation, c’est le grand thème de Tavernier. Sur la guerre, Tavernier s’offre le luxe de s’auto-citer deux fois : le documentaire (Lyon, le regard intérieur, 1988), genre où Bébert excelle, avec son père, René, écrivain et directeur de Confluence, hommage peu pertinent au papa bien plus talentueux que son fils qui le désespérait tant, et Laissez-passer (2002). Heureusement, il a la décence d’indiquer qu’il n’est pas historien – manque les témoignages de J. Siclier; il faut dire que l’autodidacte a raté toutes les écoles possibles comme sciences Po et autres. Encore moins historien du cinéma : il est un passionné averti et cultivé. Il faut dire que dans le riche Un voyage avec Martin Scorsese à travers le cinéma américain (A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies, 1995), le cultivé Martin s’était adjoint l’aide du précieux historien du cinéma, Michael Henry Wilson, plus sérieux qu’Ollé-Laprune. Pourquoi Tavernier n’a pas travaillé avec l’excellent N. T. Binh de Positif, revue née à Lyon ou Rissient avec qui il a été attaché de presse par exemple ? L’apport des étrangers est primordial, Tavernier a raison. Ont profité des départs, Becker, Clouzot, Autant-Lara, ces derniers affirmant qu’il s’agit d’un âge d’or, ce qui choque mais nombre d’enfants de l’époque ont bien clamé que c’était une période dorée. Affirmer que les metteurs en scène ou personnels du cinéma ont eu globalement un comportement exemplaire relève de l’aveuglement idéologique digne de Clément envers les travailleurs du chemin de fer (La bataille du rail, 1946) –souvenons-nous de la perte du procès par Lipietz contre la sncf et les transports de juifs, entre autres, dans les camps. Tavernier s’extasie sur un passage chez Guitry (Donne-moi tes yeux, hum … 1943, film vanté comme relatant les difficiles conditions pendant la guerre – il ne faut pas pousser !) où le spectateur ne voit que les jambes des protagonistes, éclairées par une lampe torche, avec les paroles échangées en voix off. Un type aussi cultivé que Tavernier ne peut ignorer que cela a déjà été pratiqué dans un film muet de la Gaumont dans les années 10 (Des pieds et des mains, Ravel, 1915 d’après Histoire d’une paire de jambes, auteur inconnu, 1909). Rien sur le rôle trouble de Guitry pendant la guerre, thème qui nourrira pourtant un épisode suivant de la série de Tavernier, bizarre. Certes l’acteur Francis Huster, d’origine juive, défend Guitry becs et ongles, Sacha a défendu le droit de jouer en toute circonstance mais les doutes subsistent. Mais n’est-ce pas une redite par rapport à Guitry cité plus amplement dans un autre épisode ? Pourquoi ne rien dire de la paradoxale Arletty, proche de Céline et pour qui son « cul est international », qui a aidé à ce que Trauner travaille malgré un froid persistant en studio ?
Tavernier casse le mythe du cinéma, pourtant majoritaire, pro-résistante en s’appuyant sur Jericho d’Henri Calef (1946 avec Heymann et Spaak au texte). Il était certain que Tavernier rajouterait une couche sur son chouchou et bien oublié, mais aucunement un réalisateur majeur, Le Chanois (L’école buissonnière, 1949, …Sans laisser d’adresse, 1951). Il a manifesté contre les scandaleux accords Blum-Byrnes mais le sulfureux Autant-Lara devait être de la partie. Ouf, nous évitons la référence à Les portes de la nuit (Marcel Carné, 1946), film raté mais symptomatique d’une époque où Jean Vilar est exceptionnel et Yves Montand, remplaçant Gabin en ticket avec Dietrich, pitoyable. Quelques films que je ne connais pas : un film à sketchs (Retour à la vie, 1949, André Cayatte ; Le retour de Tante Emma, Henri-Georges Clouzot ; Le retour de Jean, où Jouvet joue admirablement un prisonnier revenu des camps, Jean Dréville ; Le Retour de René ; Le Retour de Louis). Le silence de la mer (1949) de Melville, le parrain de Tavernier en cinéma, avec un Vernon peu crédible en allemand. Une partie trop courte au regard de la complexité de l’époque.
4 La nouvelle vague de l’Occupation
Cher Autant-Lara malgré. Tavernier en scrute toutes les contradictions, et elles sont nombreuses. Jeanson a dit « C’est un con mais il a du talent ». Quoique classique et rigidifié par ses principes. Son atout, c’est son équipe (ses scénaristes, Aurenche et Bost, ses décorateurs, métier qu’il a pratiqué lui-même, les Douy, son musicien attitré Le Cloerec, son chef op’, et sa femme Ghislaine). Il rechignait à faire tourner Odette Joyeux qui est tout bonnement exceptionnelle dans Le mariage de Fonfon (1942 avec travelling sur voix off suite à l’erreur du producteur : les inventions naissent de hasards et d’erreurs), Douce (1943, cote 5, à proscrire, de la centrale catholique « utilisation sadique des chants de Noël », qui devient cote 6, au-delà de proscrire, dans un épisode suivant, avec un conflit de classe bien marqué) dans lequel la réponse à la tirade de la Moreno, coupée pendant quelques temps par Anastasie (« Je te souhaite la patience et la résignation. » ; « Souhaitez-lui l’impatience et la révolte ! ») par Aurenche et Bost a donné envie à Tavernier de tourner.
Mon chouchou Clouzot est revisité par l’auteur D. Lehan : « Il ne nous dit pas regardez comme le monde est laid mais plutôt regardez ce que nous en avons fait. ». On ne saurait mieux dire. Tavernier démêle les problèmes de Clouzot pendant la guerre de façon limpide : il décevait tant les allemands, qui le trouvaient trop pessimiste, que les français qui le qualifiaient, injustement, de collabo. Le Chanois, juif et à la tête d’un réseau de résistance, témoigne en faveur de la Clouz. Personne n’a pardonné à Clouzot de mettre le fer sur la plaie. C’est pourtant le boulot de l’artiste. Le rôle des femmes, notamment l’invalide, Ginette Leclerc en Denise Saillens, dans Le corbeau (1944 cote 6, au-delà d’à proscrire, de la centrale catholique), est éminent. Dans Quais des orfèvres (1947), le côté humaniste du père commissaire lors des interrogatoires, avec explication de l’expression « se mettre à table », lors de ses rapports avec son fils dans une ambiance coloniale voire colonialiste. Son côté chrétien, apparu après un certain temps, et surtout sado-masochiste, flagrant dans son dernier film, La prisonnière (1968) est gommé. Le travail avec les artistes (Picasso, Le mystère Picasso, et Karajan) est malheureusement occulté par le documentariste Tavernier, dommage. Il revient plusieurs fois sur Manon (1949, d’après le roman de l’Abbé Prévost), ce chef d’œuvre malgré Cécile Aubry que Clouzot a pas mal maltraité. Tavernier tente maladroitement de réhabiliter le raté, de quelque façon qu’on le prenne, Les espions (1957), sans oublier le bon mot de Jeanson, « Il a fait Kafka dans sa culotte ».
5 Les oubliés
Maurice Tourneur a bercé ma jeunesse et mon amour pour les années 30. Mais pourquoi Tavernier oublie-t-il ce chef d’œuvre Le val d’enfer (1943) ? Si j’avais adoré jeune Justin de Marseille (1935) à cause des nombreux changements de tons, j’ai été horriblement déçu à la revoyure au Festival Lumière en copie neuve : comédie musicale avec les poncifs sur Marseille. Les gaîtés de l’escadron (1932), c’est Le gendarme et les gendarmettes (Jean Girault, 1982) de l’époque. Rien sur sa prolifique carrière tant ignorée lors du muet dans un épisode précédent.
Litvak est peu connu malgré une grande filmographie. Litvak n’est pas russe comme l’indique Tavernier mais ukrainien sous le régime soviétique, cela est fort différent, outre le contexte politique, géopolitique et historique, lorsque l’on connaît l’importance de l’école ukrainienne de Dovjenko (La Terre, Земля, Zemlia, 1930) à Chepitko (Les ailes, Krylya, 1966). Il insiste sur Cœur de lilas (1932) tourné après avoir travaillé à la UFA. Le côté engagé (Pourquoi nous combattons, The nazis strike, Divide and conquer, 1943-1945, films de propagande au côté de Franck Capra et Ford) est souligné. Il mentionne rapidement l’excellent thriller Raccrochez, c’est une erreur (Sorry, Wrong Number, 1948) avec le bon soldat d’Hollywood, Barbara Stanwyck, et Burt Lancaster, film projeté dans la très prisée section Art of noir avec Eddie Muller de Frisco et le taciturne mais belle plume Phil Garnier lors du Festival Lumière 2013 avec remise de prix à … Tarantino. Exit La Fosse aux serpents (The snake pit, 1948), un film sur la folie avec Olivia de Havilland, la délicieuse et surannée adaptation de Sagan avec Aimez-vous Brahms ?, Good-bye again, 1961 avec Ingrid Bergman, Yves Montand et Anthony Perkins. Finir avec le fait que Tarantino trouve sa fin de carrière, avec La Dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil (The lady in the car with glasses and a gun, 1970 en eastmancolor d’après un roman de Japrisot), cool, apporte peu de choses – c’est un effet du relationnel, mot poli pour évoquer le copinage éhonté, lors du Festival Lumière 2016.
Grâce au Festival Lumière j’avais découvert Raymond Bernard, le fils de Tristan. C’est classique (Les croix de bois, 1932, avec des scènes de batailles sidérantes où nous sommes embarqués comme dans Il faut sauver le soldat Ryan, Saving Private Ryan, S. Spielberg, 1998) mais de haute tenue. Pour une fois, Tavernier a raison : son adaptation de Les Misérables (1934) est la meilleure car proche du roman populaire de Hugo, avec des acteurs extraordinaires (Harry Baur en Valjean, Charles Vanel, cet acteur vieux déjà jeune, en Javert, Dullin et Moreno en inoubliables teigneux Ténardier ; les opérateurs pleurèrent sur le plateau lors de la mort de Gavroche) et des plans hollandais expressionniste, malgré la tonalité réaliste, pour coller au livre.
René Clair est réévalué mais pas sur le bon axe : ce qui est important, c’est ce mélange dadaïste/surréaliste, de réalisme et de rêves entremêlés. En faire un tenant du classicisme et de la qualité française est donc bien, comme l’indique Tavernier, une imbécilité de critiques.
René Clément a été épinglé « qualité française avec Les maudits (1947). Il est presque pré Nouvelle vague avec Monsieur Ripois (1954), un homme dans la foule, toujours avec cette notion de mouvement ; Tavernier n’aborde pas ce point. Que Jeux interdits (1952) soit une extension d’un court métrage ne m’étonne point tant le propos est vain. Il est vrai toutefois que c’est l’un des rares films où l’on voit l’exode. La bataille du rail (1946) a été un film de commande, intéressant sous l’angle des enjeux de mémoire, qui a entretenu le mythe de la France entièrement résistante, ce qui est totalement faux : c’est un film de propagande ou de manipulation mémorielle, même si c’est pour la bonne cause.
Un hommage au musicien Van Parys était nécessaire tant il a œuvré dans le cinéma français. Mais nous sommes abreuvés de comédies musicales, certes de bonne humeur mais tout de même de seconde zone, de Jean Boyer. Encore une fois des spectatrices dans leur siège fredonnent faussement les airs – insupportable.
Au total, nous n’apprenons personnellement pas grand’chose à part quelques détails insignifiants, souvent des anecdotes inutiles, ne changeant aucunement la compréhension de l’histoire du cinéma.
6 Les méconnus
Oubliés, méconnus, quelle différence ? Vallée, ne connais pas mais ne paraît pas impérissable. Premier film en couleur en 1936 ? C’est oublier les films muets coloriés à la main, au pochoir puis en kinorama, etc. Arte y avait consacré une série avec Loïe Füller et ses disciples.
Pierre Chenal inconnu ? Il l’est tellement qu’il a fait l’objet de remakes importants tels que Le facteur sonne toujours deux fois (The Postman Always Rings Twice, Tay Garnett, 1946 avec rien moins que Lana Turner et J. Garfield) et celui, encore plus sulfureux, de Bob Rafelson (1981) avec Jessica Lange et Jack Nicholson à partir du Dernier tournant (1939), adapté du roman de James M. Cain, film qui n’est même pas cité alors que c’est son plus connu ! Ceci m’a donné envie de voir Rafles sur la ville (1958), film mineur, pour voir Vanel vieux alors que même jeune, il l’était déjà, vieux. Méchant, il l’était déjà dans La belle équipe (J. Duvivier, 1936 : film à deux fins !), un film nettement supérieur au lourd Le crime de Monsieur Lange.
Calef, son assistant, n’a tourné qu’une dizaine de films qui n’ont pas marqué l’histoire du cinéma. Et voilà que Tavernier recite Jericho (1946) – que de redites décidément ! Il n’a pas réalisé que des Dossiers de l’écran pour la tv. Viviane Romance et Anouk Aimé dans La maison sous la mer (1947), ok. Mais quid de Max Dalban, Gabrielle Fontan et Dora Doll ? Rien dessus ! L’heure de la vérité (1965), très bien ; sujet original et dérangeant. Rien sur l’acteur principal Karlheinz Böhm (passons sur les Sissi, 1955,56,57 mais l’incroyable Le voyeur, 1960 par un Michael Powell que Tavernier révère, en plus ; Les quatre cavaliers de l’apocalypse, The Four Horsemen of the Apocalypse, V. Minelli, 1962 ; l’excellent Rififi à Tokyo, 1963 par son pote Deray). Aucune mise en relation de Corinne Marchand, actrice principale de Cléo de 5 à 7 (Varda, 1962), alors qu’il cause de Varda plus loin ! Hallucinant !
Sur les réalisatrices, il a l’honnêteté de citer Alice Guy et Germaine Dulac. La filmographie d’Audry, sœur de Colette (le scandaleux érotique Histoire d’eau) et de la famille du politique Doumergue, est classique sur une petite dizaine de films même si les thématiques sous-jacentes sont osées. Aucune audace stylistique : son cinéma a vieilli. Néanmoins Olivia (1950) a un charme suranné où Edwige Feuillère excelle à lire des textes classiques (Racine, Lamartine), Noiret a un rôle croquignolet. Mais le témoignage de Delorme, épouse d’Yves Robert, sur une mauvaise VHS dans cette émission de TMC où participait le conseiller historique peu éclairé, Ollé-Laprune, est d’une qualité digne d’un film amateur ! Minne, l’ingénue libertine (1950) est une bluette où Tissier en fait des tonnes comme d’habitude. Les malheurs de Sophie (1946), un classique de la littérature enfantine pour jeune fille, n’a pour seul intérêt de montrer Marguerite Moreno. La caraque blonde (1953) n’a que pour intérêt quasi documentaire de présenter la Camargue.
Varda et ses courts (Les glaneurs et la glaneuse, 2000), ses longs mais reste-t-il un grand film ? A part Cléo … Rien sur son plus connu, Sans toit ni loi (1985). Kaplan et sa célèbre Fiancé du pirate (1969), comme un manifeste féministe. Sur 6 films …
Grangier, là il touche une corde sensible. C’est un immense metteur en scène que Tavernier admire tellement qu’il le qualifie de « Becker mineur », ça serait plutôt l’inverse ! A mettre, pour certains de ses films, juste derrière Melville ! C’est le metteur en scène qui a le plus travaillé avec Gabin car ils étaient potes et leurs femmes aussi : Le désordre et la nuit (1958) bien sûr, comme étalon du film noir selon l’excellent et regretté Alain Corneau. Le cave se rebiffe (1961) bien sûr ; Audiard, d’accord, mais qu’a-t-on à faire de l’anecdote du BSA l’extrapiste ? Rien sur l’incroyable Le rouge est mis (1957), l’un des meilleurs noirs tous pays confondus des années 50. Gas-oil (1955) a un charme où Moreau est révélée comme Bozzu ou encore Girardot dans un autre de ses films. Grangier a une profondeur dans la prise en compte du quotidien – comme chez Jules Dassin –, qui n’est qu’un fond journalistique chez Decoin ou Becker. Tavernier donne envie de voir Le sang à la tête (1956) d’après Simenon.