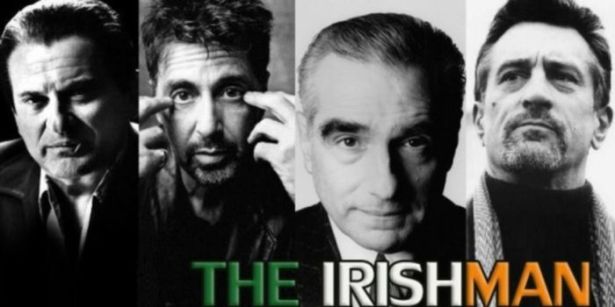Se lécher les babines et les yeux en voyant la fin du marché de poisson à la criée sur le vieux port. Un bus 83 arrivant enfin, me voici arrivé à Fausse monnaie sur la Corniche Kennedy, passés le vallon des Auffes et la plage de Malmousque. Le quartier d’Endoume, la anse de Maldormé. Passé Passédat, héritier d’une famille d’artistes, ancien élève d’Alain Chapel, des frères Troisgros et de Michel Guérard, me voici au-dessus de plagistes se bronzant en pleine vacance de Toussaint alors que les vagues fouettent les rochers. Un couloir en plein air qui pue la pisse, je tourne en rond, je trouve finalement le 1917 grâce à un taxi sortant du parking. Je passe la magnifique piscine, non utilisée à cet instant, qui préfigure l’architecture du relais et châteaux par Rudi Riciotti (le MuceM). Tout le contraste de la triste et aimée mais aussi détestée Marseille ou Phocée : la grande classe qui surplombe les gens qui, en dessous, n’en ont rien à foutre – et ils ont bien raison – et se grillent au soleil encore égal pour tous, heureusement. La délicieuse dame m’a gardé une place devant les vitres avec double vue : à droite, une île privée, qui a appartenu au bijoutier Morabito, père du designer Ora-ito qui a pignon à la maison du fada, au vallon des Auffes ; plus loin, le Frioul. A gauche, la rade de Marseille, représentée en 3D par du relief de plâtre creux et blanc sur la table. En bas, de belles baigneuses qui se lancent dans l’eau en plein soleil, un 29 octobre ! Les rideaux noués tremblent au vent : impression d’être dans un film – Le Mépris de Godard ? La pièce, spacieuse, qu’agrandit un magnifique grand tableau abstrait du génial peintre Marseillais Traquandi, n’accueille qu’une dizaine de tables loin d’être toutes remplies, des chaises blanches orientables d’un design des années 60-70, un verre-ciboire Stark, un petit promontoire en argent, avec un poisson accolé, pour y poser le couteau à poisson. Un immense Saint-Pierre, le paradis dans l’assiette, est présenté. Choix : pain de campagne ou pain blanc. Penser à Poisson sur une assiette du nabi japonisant Pierre Bonnard au Musée des Beaux-arts de Lyon.


Une jeune femme, fine et grande, brune aux cheveux décolorés vers le bas avec petit chignon, élégante dans son tailleur, un bracelet discret en or, sert. Le sommelier, un grand méditerranéen, un vieux plutôt jovial mais échaudé que je ne prenne qu’un vin au verre : ouf, il ne me fera pas son numéro à la Raimu, pourtant né à Toulon. Il n’a pas l’air convaincu par ma démonstration que, ne pouvant boire que du vin rouge, un pinot noir d’Alsace ou de Bourgogne, par exemple, pouvait accompagner un poisson. Allons pour Un Beaune Côte de Nuit 2014, le type m’évite un Côte Rotie, mon péché mignon, à la peau des fesses. Je goûte et dis « on ne discute pas ! » tant le vin est incroyable par son côté à la fois fruité, mais pas trop, et tanique marquant le fait qu’il a eu le temps de vieillir en fût ; « on peut toujours discuter ; le vin sert à ça. », rétorque-t-il.
En amuse-gueules, une incroyable longue herbe corse verte, un peu comme du céleri, mais en plus évolué, sur son lit de glace, pour conservation, à plonger dans un humus du cru, il pleut plein de petites fleurs délicieuses à croquer (orange, jaune, etc.) ; un gressin, gratté à l’huile d’olive sicilienne, avec sumac des calanques présenté entier devant nous – rouge, rouge, rouge qui tombera sur la table ; un incroyable bouillon de rouget de roche avec de l’anis étoilé qui éclate en bouche ; une raviole en vitraux de Saint Victor (ah, les navettes de là-bas, dans le croquant, la fleur d’oranger – un hommage aux marins !) avec crudités sur un fond d’artichaut avec, à côté, artichauts crus de Sardaigne. Un italien, toque en tête, moustache de hipster à la Cardoz, présente une focaccia, un mix de plusieurs régions selon lui, aux incroyables tomates cerises de Provence arrosée d’huile de Toscane. Dès l’entrée en table, deux petits pots blancs bien distincts sont présentés : sont versés dans des petits plats prévus à cet effet, une huile de Toscane donc, très proche de l’incroyable Perdissaca Buža croate (élue meilleure huile du monde 2019) trouvée à Dubrovnik / Ragusa, perle de l’Adriatique), d’une ardance toutefois peu prononcée (la forte ardance, gage de qualité, peut heurter le public) et une huile de Provence, près de Maussane ( à base de picholine donc ?), je crois, plus douce et totalement différente, très intrigante voire mystérieuse car au caractère peu prononcé. Je me gave littéralement de ces deux huiles sur du pain ou en cuillère, quelques gouttes tombent sur la nappe en tissu d’un blanc qui était immaculé. Est-ce de l’huile Alexis Muñoz, celui qui fournit Anne-So Pic, Viannay de la Mère Brazier, Têtedoie, le Savoy, etc. ? J’opte pour le menu Passédat (270 €) au déjeuner. Un mistral insistant calme le soleil en fer blanc : les plats refroidiront très, voire trop, vite malgré les précautions prises (cloches, etc.).
Deux très belles tentacules onctueuses de poulpe découpées en lamelles. Curieuse infusion d’aubergine, à tendance poivrée, à la menthe fraîche du Maroc, forte à vous réveiller un mort. Passent les 3 poissons, grâce à la pêche de Christian, souvent cuits à basse température. Arrive le plat signature de Passédat, héritée de sa grand-mère cantatrice, photographiée par les frères Lumière : le loup de palangre Lucie Passedat ou pavé épais cuit à la vapeur, décoré de craquants et délicieux rubans colorés de courgette et concombre, avec une teinte de camaïeu de verts sombre et clair sur une base densément parfumée (tomate rouge et verte, citron, basilique, coriandre, fenouil sauvage, huile d’olive, pointe de truffe noire – rappel de ses racines du Quercy) sur lit moelleux à déguster à la cuillère.

Un discret accord terre/mer qui change du htv (homard tête de veau de Têtedoie). Délicieux mais, méditerranée oblige, l’huile abondante rend le plat trop gras comme en Grèce ou ailleurs, comme un effet de saturation voire d’écoeurement. Accompagné avec une sauce à la truffe noire toujours bienvenue, les frères Marcon ne seront pas jaloux. Problème : à aucun moment le goût de la truffe ne transparaît, seule sa texture reste. La belle serveuse lâche, avec son accent marseillais, que j’ai fait honneur au plat.
Un plat incroyable : la poutargue (au mulet, bien sûr, il en existe d’autres ?!!) est présentée entière puis découpée en lamelles. C’est tellement fort en bouche que le reste, dont, comme Alain Ducasse (Plaza Athénée) ou encore Bernard Pécaud (L’Ambroisie), un magnifique caviar Schrencki d’un lac du nord de la Chine, Qindaoh dit le lac aux milles îles, où il faut attendre une dizaine d’années pour atteindre une bonne qualité d’œufs d’esturgeons – qui va jusqu’à 120 kg ! – à leur deuxième voire troisième ponte. Un magnifique champignon blanc et beau, comme une estampe japonaise, rare mais son goût ne me convient pas – trop aigre, contrapunctique. Le jardin marin est une merveille visuelle avec bouffée d’iode relevée de criste marine au goût vif et puissant de roche. La moule est charnue, l’huître tombe dans la soupe, c’est-à-dire un bouillon de planctons, riches en vitamine c et qui permet de lutter contre le scorbut, qui revient actuellement, présenté dans une conque, et tâche ma chemise pour ma lecture-performance avec un pistolet de capitaine Flam dans l’auguste salon du FID (Festival International du Documentaire) avec stuc rococo, peinture licencieuse XVIIIe en plafond et sièges noirs fort confortables nonobstant une excellente acoustique. Un filet de sardine, normal puisque les Sardes dînent à l’huile. La chair tendre d’un coquillage proche du couteau, du concombre de mer. Pour remonter le palier de l’apnée gastro, un bouillon avec une bizarre texture filandreuse en tube, entre la coquille Saint-Jacques et le salsifis : une mauvaise impression.
Le trou normand, terme qu’ignoraient les personnes au service, est un verjus, c’est-à-dire des grains de raisin très acides recueillis en juillet, nous est-il expliqué par une jeune acnéique concurrençant un serveur boutonneux, glacé, – mais moins que les autres jusqu’à ramollir comme une bite non d’amarrage mais d’ancêtre, étant le dernier arrivé-, puis râpé, neutralisé avec une sauce plus douce avec bouts de glace, le tout surmonté de gingembre éclatant.
Le frometon est peu surprenant – ce n’est pas la saison de l’excellente et délicate chèvre toute de cornes torsadées en forme de lyre du rove de la Côte bleue servie en tube et affinée au vinaigre car tout le secret est dans le dosage -, avec une tome de tome et une autre tome avec une sauce verte très relevée avec de l’aubergine, un parmesan de 36 mois et une mi-mollette vieille, à part ce chèvre des Arnavaux accompagné de confiture de fruits rouges. Un peu décevant. C’est plus roboratif chez Bocuse mais, ma foi, je me suis ici bourré le bédelet pour un bon pénéquet. Un pain encore chaud avec du raisin.
Le dessert est incroyable, le père de Passedat était boulanger-pâtissier : des mikados en meringue sur une figure en forme de croissant aux multiples saveurs à manger de gauche à droite. Très esthétique. Plaisantes sont les mignardises avec miel de forêt des Pyrénées à plus de mille mètres montré dans son cadre ; sur un plateau façon tea time, une tartelette d’avocat incroyablement travaillée, des raisins secs qui pendouillent comme des couilles de centenaire, une figue noire à la peau légèrement violacée de Solliès, AOC depuis 2006 et AOP depuis 2011, d’une incroyable finesse de chair et de texture, une espèce de mendiant de céréales ou plaque bourrative pour sportif avec crème légère sur le bout, et un nougat avé pistache de Sicile et miel. A côté, un roudoudou, bonbon au grand succès enfantin dans les années 60-70 : lécher la confiserie collée à l’intérieur de la coquille.
*
Un grand et beau voyage dans les divers bords de la méditerranée, beaucoup de bouillons raffinés qui laissent songer au dashi très utilisé par Pic depuis son séjour nippon ; trop d’huile, peut-être, dans les plats mais c’est la touche méditerranéenne qui manque ici singulièrement d’ail. Des saveurs parfois trop fortes – la mer s’impose naturellement – qui écrasent la richesse d’autres senteurs et goûts. Ainsi le goût du poisson n’est pas perceptible, contrairement aux plats à viande, gibiers notamment. Il reste au moins la texture. A part les bouillons, peu de points communs avec les japonais, qui, je trouve, mettent plus en valeur les saveurs marines tout en l’ornant de façon équilibrée : leur culture est totalement différente mais plus en osmose, peut-être grâce au shintoïsme, avec le milieu marin. Je mettrai 2 étoiles et demi, soit plus près de deux étoiles que de trois étoiles ; disons que l’impression ici est d’être dans un deux étoiles qui aspire à la troisième. Bref, je ne suis pas complètement convaincu, d’autant qu’il y a, heureusement, de rares moments où le goût est détestable du fait de certains produits marins. Il faudrait voir lors du repas du soir, plus fourni, du printemps en général, de la période des oursins, des anémones de mer et du chèvre du Rove (printemps-été). Anne-Sophie Pic est toujours la meilleure (son restaurant à Londres a gagné une étoile de plus), je n’ai, pour l’instant, pas trouvé mieux. Reste à savourer le coucher de soleil aux premières heures d’hiver sur la terrasse de la Caravelle sur le vieux port où l’esprit jazzistique d’Elangué, du coltrainien Imbert et du patron Jean-Louis plane.