L’obsession de Madame Craig, Craig’s wife, Dorothy Arzner, 1936, 1h13, noir et blanc, 1:37, numérique, Institut Lumière, Hangar
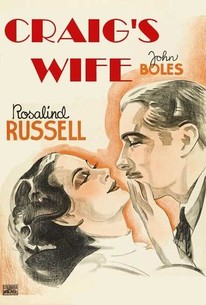
Tôt le matin, l’habitué et taciturne Philippe Garnier, chaussé d’un chapeau de cake et d’un jean crade noir, attaque l’histoire permanente des femmes cinéastes avec Dorothy Arzner (1897 à Frisco-1979) avec une copie provenant de l’UCLA où elle enseigna (1959-1963). Pour lui, cette serveuse devenue sténodactylo puis script-girl, lectrice de scénario, scénariste, monteuse (assistante puis chef sur Arènes sanglantes, Blood and Sand, Fred Niblo, 1922 avec Rudolf Valentino, Lila Lee et Nita Naldi, d’après Juin Mathis, où elle devait couper à la main beaucoup de scènes, filmer une corrida à partir d’images d’archives) n’est pas une pionnière comme la réalisatrice, dès 1912, scénariste, actrice et productrice Alois Weber (1881-1939) ou encore Wanda Tuchock. Arzner a pourtant inventée le micro perche.
Arzner a effectué une carrière de premier plan et longue d’une vingtaine d’années dans les studios (1927-1943 soit 16 titres en 15 ans). Elle sera la première réalisatrice membre de la Directors guild of America (Académie des cinéastes) ; elle aura sa place dans le Walk of fame. Fille d’un restaurateur d’Hollywood fréquentant nombre d’acteurs, elle s’intéresse finalement au cinéma suite à la visite d’un studio alors qu’elle suit des études de médecine. Alors qu’elle envisage d’intégrer la Columbia en tant que réalisatrice, elle entre en 1919, grâce à William C. DeMille, frère aîné de Cecil B., scénariste dans la boîte, rencontré chez les ambulanciers volontaires de la ville, pour mettre en scène Fashions for women (1927) aux studios Famous Players-Lasky Corporation, futur Paramount. Elle y tournera le premier parlant avec la star du muet Clara Bow et Ben Schulberg, le plus vulgaire des chefs de production de l’époque. Indépendante et riche sauce « fuck your money », elle n’est attachée à aucun studio : elle quittera donc la Paramount. Elle reprenait les films en plan; elle prenait ce qu’on lui donnait. C’était le cas pour Les endiablées (The wild party, 1929) où une lesbienne – Clara Bow et ses copines de fac sont montrées dans la plus simple intimité-, ce qu’elle était tant Garnier insiste là-dessus (« cravate et costume, elle portait le pantalon »; les laconiques Mémoires d’Hepburn, qui ne s’entendait pas avec Arzner lors du tournage de La Phalène d’argent, Christopher Strong, 1933, relatent : « Elle portait des pantalons. Moi aussi. Nous avons passé ensemble de grands moments »; elle ne cachait pas son homosexualité sans l’afficher pour autant et sans mettre en délicatesse les studios), était traitée comme un cas pathologique à guérir d’après le roman dont est tiré le film. Elle pourra, forte de sa position, supprimer ce personnage du scénario. Elle a noué une longue relation avec une auteure qui a écrit pour le cinéma, Mae West notamment, avec la chorégraphe Marion Morgan également, avec quelques-unes de ses actrices.
Le film est adapté d’une pièce de Georges Kelly, prix Pulitzer 1926. Il ne jouera aucun rôle dans la production ; Arzner avait un point de vue tout à fait différent. Elle obtient d’Harry Cohn de la Columbia de pouvoir changer le décor à l’aide de la star du muet et homosexuel détruit par Meyer (MGM), W. Heintz, en le rendant plus théâtral et oppressant. Le script a été protégé contre l’ingérence de Harry Cohn ; Eddie Chodorov était le producteur superviseur. Comme la Phalène d’argent (Christopher strong, 1933 avec l’indépendante et à voile et à vapeur Catherine Hepburn en athlétique à culotte de cheval), le film, le plus connu d’Arzner, est un succès. Elle est retombée dans l’oubli malgré la redécouverte par les féministes dans les années 70 et 80 (Festival des femmes de Créteil; une lecture gender studies avec la théoricienne Claire Johnston. The work of Dorothy Arzner : towards a feminist cinema. London : British Film Institute, 1975. 34 p. voire lesbienne avec Mayne, Judy. Directed by Dorothy Arzner. Bloomington : Indiana University Press, 1994. Women artists in film. 209 p.) dont Jodie Foster qui finança une partie de la restauration, et le soutien de son ancien élève dans les années 60 à l’UCLA (Los Angeles), Francis Ford Coppola.
Le personnage principal, Harriet Craig, plus déprimant à l’origine, permet, malgré une mauvaise relation avec la metteure en scène, à Rosalind Russell, alors inconnue du grand public, de devenir une star, spécialisée notamment dans les langues de vipère (cf. The women, G. Cukor, homosexuel également, 1939 ou le vrai tournant de carrière selon l’actrice). Arzner lancera également les carrières de Clara Bow, Lucille Ball et bien d’autres. Ici, elle rend les choses plus complexes : la TOC est touchante; tout est généré par un traumatisme d’enfance. Au point que le spectateur peut compatir pour la pathologie d’Harriet. A noter que, pour une fois, nous sommes en empathie avec le mari qui, étonnamment chez Arzner, n’est ni veule ni alcoolique. Les personnages secondaires sont finement travaillés. Les protagonistes évoluent par couple (la mère et la gouvernante ?). Dorothy Parker, déjà scénariste notamment d’Une étoile est née (A star is born, William A. Wellman, 1937) ainsi que la scénariste attitrée d’Arzner, Mary C. McCall Jr, confrontent les visions féminines du mariage.
Elle a fini par arrêter le cinéma car cela n’allait plus avec la MGM : pneumonie ou mise au placard pour avoir voulu faire tourner un « baiser lesbien » à Merle Oberon à la fin de First comes courage (1943) ? Elle a tourné de la propagande pour l’armée puis, dans les années 50, des publicités pour Coca avec Joan Crawford, mariée avec le big boss de la célèbre marque de soda d’Atlanta. Crawford réincarnera Harriet dans La perfide (Harriet Craig, Vincent Sherman, 1950).
C’est pour moi le meilleur film vu d’Arzner car les personnages, notamment masculins, souvent idiots, inutiles, alcooliques, pathétiques ne sont pas ici caricaturaux. Ses films, tout en se coulant dans le moule des genres et des studios, mettent toujours en scène des personnages féminins qui refusent de jouer le jeu et qui le font, triomphalement ou tragiquement, savoir. Antoine Sire, auteur du récent Hollywood, la cité des femmes. Paris, Lyon : Actes sud / Institut Lumière, 2016. 1206 p. 59 €, ajoute : « Cette réalisatrice ne fait pas l’unanimité car elle s’est souvent retrouvée obligée à faire des films de studio, sans réussir à vraiment les transcender. Mais, et personne le voit en son temps, elle introduit un regard réellement féminin sur les situations. ». Je les trouve en effet assez plats sauf ici. Si Garnier trouve, dans un article de Libé, qu’Arzner est « frustrante comme auteur du film. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Son cinéma sent le renfermé », il vire sa cuti lors d’une curieuse autocritique rebirth : alors qu’il fut harangué à l’Institut Lumière par une femme du public (« pourquoi vous ne nous dites pas en quoi ce film est bien ? »), il avoue avoir changé d’avis au cours du festival grâce à divers points de vue.
Un rattrapage de Frémaux au regard des revendications féministes au Festival de Cannes ? L’histoire permanente des femmes cinéastes existe depuis le début du Festival Lumière (Alice Guy, Germaine Dulac, Ida Lupino, Larissa Chepitko). Oui et non répond l’intéressé. Non, « parce que cela donnerait l’impression qu’on se défend d’une accusation que je trouve quand même un peu injuste pour Cannes, le problème devant être posé plus en amont, dans les écoles de cinéma ». Oui, « parce que je trouve bien qu’un débat réel et légitime soit malgré tout posé à travers cette polémique ».
Dance, girl, dance, 1940 Jour 2, Institut Lumière, Hangar
Dance, girl, dance, 1940, 1h30, noir et blanc, numérique, 1:37

Suis un peu flappy après plus de trois heures de documentaires de Tavernier. Le film devait être réalisé par Roy Del Ruth, connu pour ses comédies musicales MGM avec Eleanor Powell dans Born to dance (1936), mais il a abandonné au bout de deux semaines à cause de divergences de vues, notamment sur le scénario, avec le producteur Pommer, l’ancien chef de la célèbre UFA en Allemagne alors en exil à Hollywood. Arzner, à la reprise, modifie le scénario en transformant le professeur de danse Basiloff en Madame Basilova (Maria Ouspenskaïa), une femme forte et masculine, maternelle et attachante. Le script a été écrit par l’auteure Tess Slesinger et son mari, Frank Davis, producteur mais écrivain inexpérimenté. C’est pourtant tiré d’une histoire originale, Grand Hôtel, écrite par Vicki Baum C’est le film de la fin de la participation d’Arzner à la MGM. Elle tente de relancer sa carrière mais elle fait un flop : l’échec critique et commercial se solde par une perte de 400 000$ pour la RKO. Il faut dire que l’expérience d’Arzner dans les comédies musicales était limitée : elle avait seulement co-dirigée Parade (Paramount, 1930). Après avoir terminé le montage sur ce film, Robert Wise a travaillé derechef sur Citizen Kane (Orson Welles, 1941).
Film sur les coulisses du music-hall des années 30, avec rivalités artistiques mais solidarité sur les revendications, le thème ici est un peu tendance flashdance. C’est divertissant. C’est un long amour d’Arzner, Marion Morgan, qui a chorégraphié les séquences de danse. Rien de bien transcendant, avec des passages obligés, formatés. Lucille Ball en Bubbles, à partir de la vraie vie de « Texas » Guinan, et Tiger Lily en fait des tonnes, à cause du scénario et de la direction d’acteurs. Si elles convoitent le même homme dans le film, Lucille Ball, qui fit son trou, et Maureen O’Hara sont devenus des amies inséparables pendant le tournage de ce film et ce, jusqu’à la mort de Lucille en 1989. C’est un croisement entre le triangle amoureux, deux rouquines pour une bagarre, et la réflexion sur la création (pure et divertissement), le talent et la célébrité.
L’intérêt du film est, vers la fin, cette magnifique harangue féministe de l’actrice fordienne Maureen O’Hara (Judy O’Brien), dont c’est le troisième film américain, digne de Mr Smith au Sénat (Mr. Smith goes to Washington, Frank Capra, 1939). Un grand moment d’émancipation saisissant. Une idée ? « Regardez-moi, je n’ai pas honte. Riez, vous en aurez pour votre argent. On ne vous fera pas de mal. Vous voulez que je me déshabille pour que vos 50 cents en valent la peine. 50 cents pour regarder une fille comme votre femme vous le refuse. Et que croyez-vous qu’on pense de vous ? Avec vos sourires narquois dont vos mères auraient honte. Pour le public en tenue de soirée, c’est la mode de rire de nous. On rirait bien en retour mais on nous paye pour que vous rouliez des yeux et que vous lanciez vos propos spirituels. Et pourquoi ? Pour que vous alliez ensuite vous pavaner devant vos épouses et enfants et jouer au sexe fort pendant une minute ? Je suis sûre qu’ils voient clair en vous, tout comme nous. » Les hommes n’ont évidemment pas le beau rôle. Ralph Bellamy en directeur de ballet Steve Adams est un chasseur-dragueur. Louis Hayward, un sud-africain proche de Noel Coward, était le mari d’un autre réalisateur femme, Ida Lupino, qui a été l’objet d’une rétrospective dans la même section au Festival Lumière 2014.
Merrily we go to hell, 1932, Jour 4, Institut Lumière, Hangar
Merrily we go to hell, 1932, 1h18, noir et blanc, numérique, 1:37

Garnier s’y colle encore et continue son feuilleton passionnant. C’est le dernier film d’Arzner à la Paramount à cause d’un changement de dirigeants et d’une volonté d’indépendance du studio affichée. La Paramount avait peur de la réussite de Merrily we go to hell. C’est son film le moins personnel car ce ne sont pas les scénaristes avec qui elle travaille d’habitude. C’est une adaptation de Justus Mayer de la nouvelle I, Jerry, Take thee, Joan de Cleo Lucas. C’est le seul film d’Arzner avec Sylvia Sidney, une vedette de la Paramount spécialisée dans les rôles de victimes. Des scènes seront coupées dans certains Etats des Etats-Unis. Le titre, signifiant « Joyeusement, nous allons en enfer », et ce, pendant la prohibition, à chaque fois que March / Corbett trinque, sera inquiété par le code Hayes deux ans plus tard. C’est vrai que l’on y boit beaucoup. Le placement de produit est flagrant avec un gros plan d’une bouteille de Brandy Henessey. Avant 1932, la figure de l’alcoolique n’avait que rarement été traitée en tant que telle au cinéma, si ce n’est pour présenter des scènes d’ivresse comique et/ou bagarreuse, et des ressorts dramaturgiques. Ici March incarne un personnage masculin dual à peine un an après avoir tourné dans Docteur Jekyll et Mr. Hyde (Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Rouben Mamoulian, 1931): il y a le Jerry sobre, sincère et charmeur et il y a le Jerry alcoolisé, imprévisible et irresponsable. Sydney prône la liberté du couple (« single lives, twin beds and triple bromides in the morning ! », « une vie de célibataire, des lits jumaux et trois aspirines le matin ») où le jeune Cary Grant n’est pas étranger.
Pour Garnier, la dramaturgie, datant de 1932, ne fonctionne pas, ce qui n’est pas faux. Ceci dit Arzner déclare : « Je me suis toujours vu trop de défauts ». Et c’est vrai qu’il y en a. Pour accentuer le côté mélo, la fausse couche n’est pas oubliée mais « my baby » sera là ! Arzner sait arranger les conventions du genre juste ce qu’il faut pour ses propres fins. Il n’en reste pas moins que c’est l’un des plus gros succès de l’année. Le film est plus centré sur les obsessions individuelles et les pulsions destructrices que sur l’alcoolisme.
Anybody’s woman, 1930 Jour 6, Institut Lumière, Hangar
Anybody’s woman, 1930, 1h20, noir et blanc, numérique, 1:20
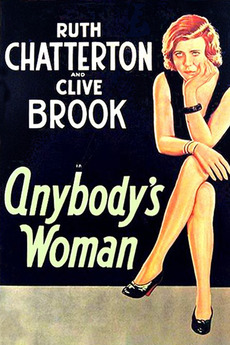
Tarantino et Schatzberg sont assis dans la salle. Garnier souligne que c’est un film rare; la copie vient de l’UCLA. Zoé Atkins, l’une des scénaristes attitrée d’Arzner, est une dramaturge, compagne essentielle de Dorothy, lesbienne fortunée aussi; elle écrit également pour Cukor. L’actrice Ruth Chatterton est une vedette de Broadway au sommet de sa carrière versatile. Si elle joue un rôle difficile dans un mélo où elle campe la femme par qui le scandale arrive, la voir dès le premier plan avec les cuisses ouvertes, jarretières dehors, ukulélé bien placé et chaussure qui pendouille au bout du pied droit, très sexy quoique vulgaire, pas d’erreur nous sommes avant l’adoption du Code Hayes. A part cette séquence sidérante, rien de notable : rapports hommes (bourrins) / femmes (complexes); conflits de classes. Paul Lukas joue habituellement des rôles de marins, de personnes d’Europe centrale. Clive Brook joue le bourreau des cœurs à 5000 $.
