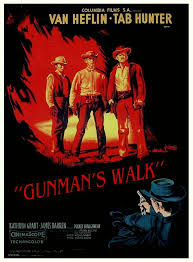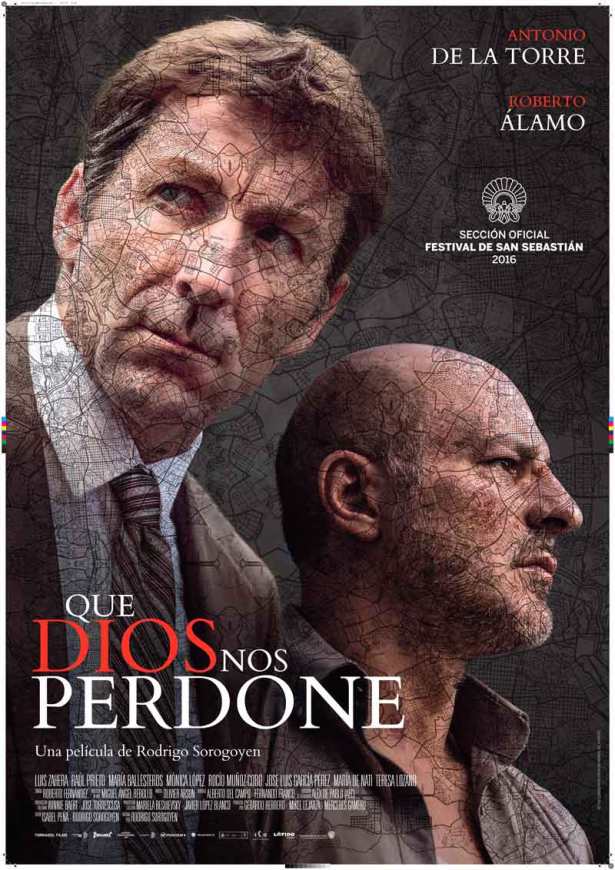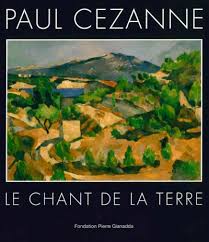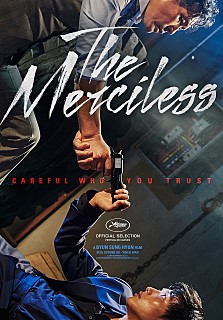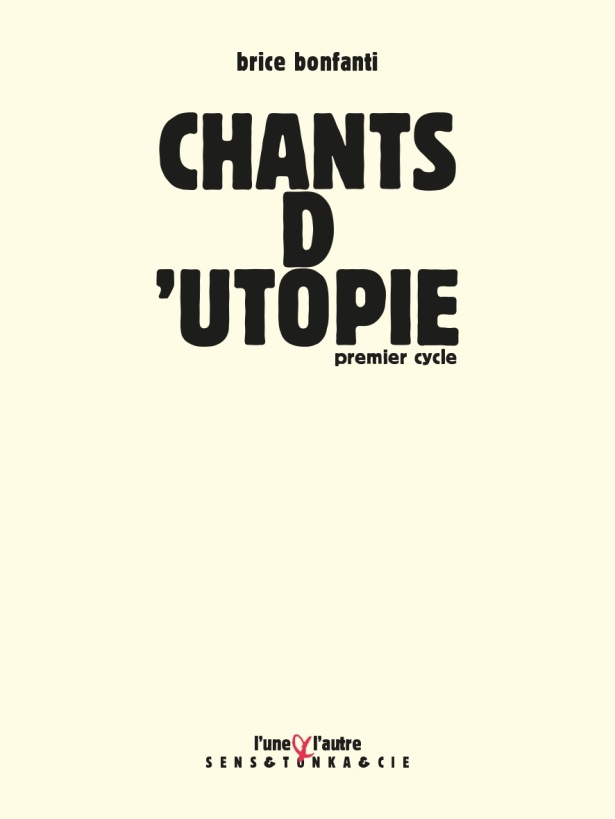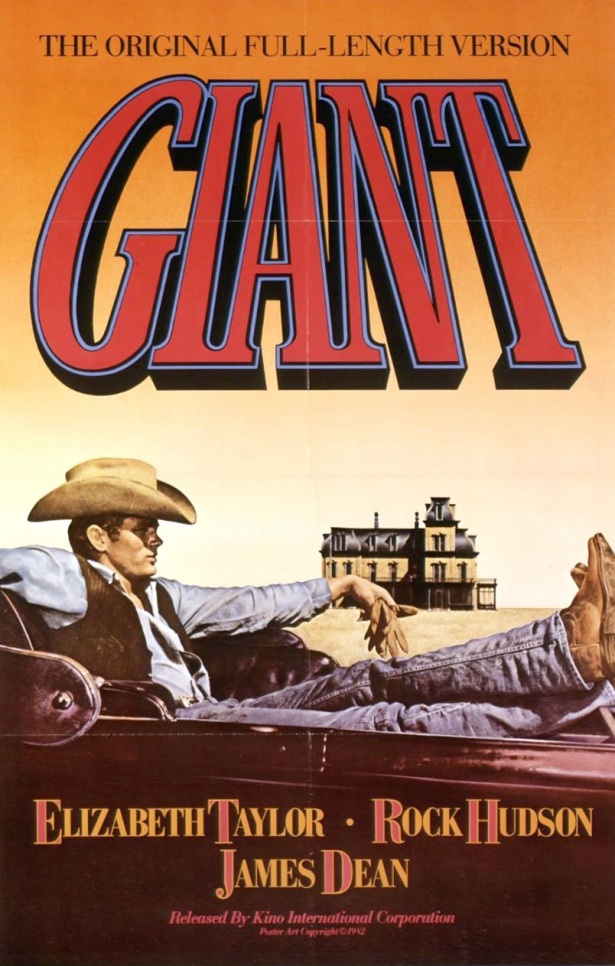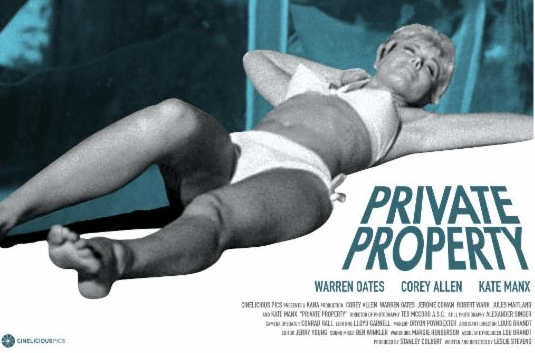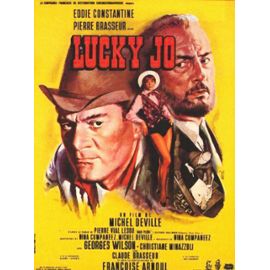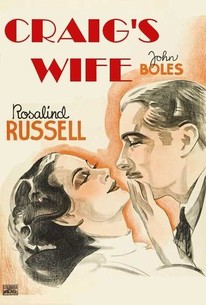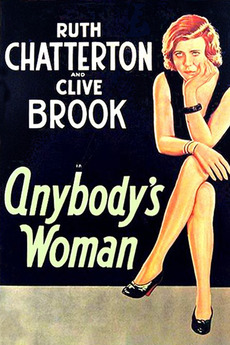[Jack White aux Nuits de Fourvière, dim. 08/07/18]

Hasards
J’avais raté Jack au Transbo en 2012 après son projet avec la belle Alison Mosshart, venue tout droit de The Kills pour créer avec Jack The Dead Weather. Fait inédit ici : après désistement, les Nuits de Fourvière me téléphonent pour me dire qu’étant sur liste d’attente, la place est en vente. Bien m’en a pris puisqu’un billet de Massive Attack (20 ans de Mezzanine déjà, très belle poésie visuelle sur chiffres binaires et jeux sur extraits d’actualité en français mal traduit avec des fautes d’orthographe projetés sur écrans, une belle voix chaude d’une black enveloppée faisant passer Jessie Norman pour une anorexique, remémorant un tube culte des années rave réactualisé sauce migrant.e.s ou réfugié.e.s mais squizzant malheureusement l’excellent Teardrop – sans Lize Fraser des Cocteau Twins, il est vrai alors qu’un jamaïcain aux dreadlocks blanchis révèrbe de voix comme H. Andy) a été également mis en vente au dernier moment. Notons que le « comité d’entreprise » du service public n’a pas fonctionné cette année : aucune ristourne même si les 45€ de White surprennent en bien au regard des 58 € de Massive (Nick Cave, c’était au moins 65€, encore plus pour Radiohead), certes avec un jeu de scène plus évolué. Beau temps, contrairement à l’excellent et entraînant, entêtant LCD soundsystem, un synthé impressionnant digne de l’Eniac avec une musicienne déguisée en groom de luxe tel Mercury s’inspirant de Metropolis dans Radio Gaga, avec attente et concert sous la pluie battante, le pire concert en 10 ans du point de vue météo.
Attendre
Eclaté par une nuit du regretté P. Bellemare, et ses belles heures radiophoniques sur Europe 1, à France cul où Léautaud s’exposait avec verve et onomatopées en face de Clavel (celui de « Messieurs les censeurs, bonsoir ! »), avant les entretiens de Mallet donc, et où un Mardi du cinéma est consacré à Les enfants du paradis (M. Carné, 1945 ; avec un témoignage d’Arletty de l’INA et le passionnant Trauner) alors que le mistral souffle frais en pleine canicule avec la lune en premier quartier cuivré. Maintenu en éveil grâce à un merveilleux Yun Feng n°1, un thé vert chinois du Zheijiang, un primeur de printemps du 10 avril acheté au Cha Yuan dans une théière translucide de chez Harrods. 28 tasses de thé soit 2 litres, pisser tout l’après-midi et envie d’uriner, sans urgence, lors du concert mais la déshydratation est loin. Après avoir enfilé un tee-shirt Laspid blanc en coton bio fabriqué au Portugal avec, en noir, Des glaneuses de Millet sur fond de centrales nucléaires comme au Buget près de la rivière le Longevent vers Pérouges remémorant une photographie impressionnante du taiwanais Yuan Goang Ming, mélange de Gursky et Parr réussi, exposée lors de la biennale d’art contemporain de Lyon 2015, je quitte la maison sur France cul causant du tour de France alors que Froom est justement hué.
2h30 en avance à la Nuit de Fourvière. Grandes heures : une dame fouille en premier filtre. Attente habituelle en 3 files ; une jolie grande femme seule, sexy, peau bien bronzée, celle qui a vu péter le loup, basculant vers la deuxième période de vie mais qui a encore de nombreuses ressources, avec du monde au balcon et des chaussures d’été kitsch flashy : une fan de la première heure qui a envie de jouer les vestales pour Jack et ses prises. Est-ce elle qui donnera un cadeau sur scène enrobé en papier kraft avec une étiquette « all my love » en caractères noirs sur fond blanc, via une jolie jeune rousse aux cheveux longs qui en jouera en headbanging comme si elle était dans un concert de métal ? Pas de soleil brûlant dans la file. Lire L’automne à Pékin de Vian en Pléiade et Positif, juin (le singe au ciné) et août-septembre (les criminels) revue née à Lyon, offerte pendant un an avec l’abonnement Club de l’Institut Lumière. Se précipiter sur le chemin de pierre chaude, comme d’hab’. Attendre encore. Go : suis premier en fosse, non au centre mais légèrement à gauche contre la barrière métallique noire des grands jours – crainte des lumières aveuglantes qui me mirent en souffrance lors des concerts d’LCD soundsystem et Massive Attack. Sexe et sueur. Attente assise sur fond de rap vintage 80’s ; à Détroit, le ghetto-blaster, Kurtis Blow et LL Cool J. balançait leur flow. Je cause avec un italien qui est venu spécialement de Gêne pour voir White qu’il avait déjà observé vers 2010 en Italie. Laurent, un habitué quadra de l’Institut Lumière, calé en ciné et nerveux, accompagné de sa maman, se lève de la pierre chaude en hauteur et me fait signe.
Ah Rico !
En première partie, Benicio del Toro s’est réincarné en un carnassier They call me Rico, loin du style de A guy called Gerald, un type, Frédéric Pellerin à l’accent canadien, qui joue seul guitare, batterie voire harmonica comme Dylan, homme-orchestre donc, avec un micro à l’ancienne, digne d’Elvis. Plein d’énergie et chantant à pleines dents en articulant en anglais comme s’il allait être opéré par un dentiste après quelques cours de théâtre, il entraîne le public, en le faisant participer, en 30 mn, sur du rock / blues / folk. La pèche ! Il arrive – luxe – à chanter sans micro avec sa guitare sèche amplifiée et emporte la mise tant c’est inédit. Incroyable et couillu. Pas novateur mais impressionnant. Quatre photographes immortalisent l’instant. Il arrive même à reprendre Led Zep, pour clore (« Je vous laisse avec Jack »), de façon originale en se centrant sur le riff principal. Des instruments faciles à bouger pour laisser la place à White. Peu d’attente, soit 30 minutes.
Jack experience
Ensemble classique à gauche : basse et sa grande bière sous coiffure rétro rock voire rockabilly avec veste en jean ; batterie sur escaliers sur roue.
Un jeu de percus sera éclairé mais inutilisé – suspense : musicien malade, viré par le tempétueux White ?
A droite : une dizaine (cinq / cinq) de synthés aux formes futuristes, un Moog sur un Hammond, au son toujours chaleureux d’œuf cuit au jaune coagulé sur le plat, et recherché, joué parfois façon Manzarek de The Doors. Ils seront utilisés par deux jeunes afro-américains venus du hip-hop, débarqués, retour vers le futur, des années 80, l’un coiffé teinté blond de mauvais goût comme un joueur de foot avec anneau noir dans le lobe tombant d’oreille à la Corto Maltese, l’autre en Stevie qui s’échine sur un Yamaha pour faire son de piano ou sur piano droit, parfois inaudible notamment lors d’une chanson mélangeant avec changements de rythmes rapides et audacieux, jazz, funky et rap, un vrai gloubi-boulga. Les types sont des virtuoses. Parfois, les nappes de synthés sont aussi légères qu’un gros gâteau à la crème ou un mauvais film des années 80 qui devrait faire les choux gras de Rockyrama voire de Schnock. White vise l’opératique mais comme pour W. A. à son époque, il serait possible de dire : « trop de notes », comme le parfois fatiguant Prince dont White s’inspire pour le décalage beat froid, électronique et voix animale à l’étendue moins développée que le défunt de Minneapolis ! White arrive même à dialoguer, guitare/clavier, sur d’anciens morceaux, voire se confondent en imitation (Over and over and over) – ce que je n’aime pas (pour un morceau, devenu un tube, la voix imite la guitare et réciproquement). White est complice avec la gauchère batteuse pas gauche. Il échange plusieurs fois quelques mots avec le bassiste et une fois avec l’un des joueurs de claviers pas tempérés. Un roadie, veste noire classe et cravate, à la barbe hipster ZZ Top nettoie les touches au pinceau large à ripoliner puis passe un coup de serviette. Il la passe touches par touches sur le piano droit vintage, mais va-t-il jusqu’à distinguer les noires des blanches ? L’incontrôlable et control freak, digne de Stanley, White semble plus obsessionnel que Gainsbourg, au point de donner la consigne de ne pas arborer de téléphone portable, enfermé à l’entrée dans un étui d’une start up californienne, pour filmer, communiquer ou autre, un agent de sécurité en profitera pour le signaler. Que le public vive le concert. Ce qui n’empêche pas un photographe accrédité de filmer une partie du live sur son téléphone, l’égalitarisme français en prend encore un coup. Du coup, aucune tablette numérique, élevée à bouts de bras, ne vient gâcher la vue. Dans son trip, où il est arrivé qu’il arrête un concert en voyant un quidam plié sur son portable, il ne semble pas être au niveau du caractère de Keith Jarrett même si sa réputation le poursuit, blase obligatoire pour sexe, drogue et rock n’ roll. C’est qu’il ne faut pas le titiller, le Jack.
Au milieu, 6 guitares, 2 provenant de Qui veut la peau de Roger Rabbit ? (Who Framed Roger Rabbit, R. Zemeckis, 1988), notamment pour les « vieux morceaux » de The White Stripes, une guitare acoustique blanche, grande et kitsch à la Elvis dernière période ou showbizz tout court avec un G et des flèches dorées, une espèce de zodiac ésotérique (pas l’assassin mais l’astrologie) avec des ailes d’ange également dorées, utilisée pour des morceaux joués en solitaire, les musiciens seront même congédiés d’un revers de main pour jouer un country basique – un briquet sera allumé à l’ancienne, un vigile intervient, symptôme d’une époque ; une drôle de guitare vintage éraflée, abîmée en bois clair pour le dernier morceau – de bravoure, Seven nation army, que le public entonne, impatient, comme dans les stades, alors que la coupe du monde sévit avant France(bleus)/Belgique(diables rouges) au pays d’un Poutine triomphant, la Russie étant arrivée à un niveau inédit, en attendant que White rapplique. Deux amplis, dont un Fender vintage, avec micros devant. Un double jeu de pédales d’effets impressionnantes. L’une sera remplacée entre deux morceaux. Un roadie mince avec un sacré tarin et un chapeau noir de cake sur cravate rose emmitouflée dans veste noire passe un temps infini à tester les diverses guitares, y compris pendant le concert, les nettoyant parfois avec une serviette et les réaccordant ; plusieurs fois, il déroulera le fil reliant la guitare de Jack à l’ampli ; une fois Jack a failli tout de même se prendre les pieds dans le tapis. 3 micros sur pied – même les bonnettes sont essuyées avec une serviette ! – dont l’un pour des effets de voix atroce confinant au laid auto-tune dominant, pire que le vocoder, en tout cas transformée par ordi ou synthé, ce n’est pas une réussite, notamment des cris dignes des Cochons dans l’espace dans The Muppet Show dans un rap aussi raté dans son flow que Spite & Malice (Black Market Music, 2000) de Placebo. La voix de celui qui est devenu quadra n’est pas exceptionnelle mais il arrive, assez facilement, à certains aigus. Un décompte ; White y fait deux fois une apparition rigolote en HD. Air décontracté.
Power
21h30. Tel un fauve qui n’a pas sucé que des glaçons, White in black (pantalon noir, banal ; un polo noir simple qui laisse entrevoir des bras travaillés par une muscul intensive confinant à la gonflette et deviner un petit bidon tendance dad bod’ – la terreur a l’air d’un sacré bon vivant; des chaussures neuves, atroces, noires et montantes sur semelles blanches à l’air de boxeur, ce qui est utile pour atteindre les pédales d’effets, qu’il utilise parfois avec retard au cours du jeu de guitare, qu’il relace entre deux morceaux sur la plus basse des marches de la scène), fonce électrisé sur son territoire, qu’il parcourt pour le délimiter, et chausse derechef sa guitare. Son visage, aux bonnes joues voire joufflu mais tellement pâle qu’il semble maquillé comme dans un trip goth’ genre Edward aux mains d’argent, (Edward Scissorhands, Tim Burton, 1990 ; une manière pour Gillis de devenir White) est masqué par des cheveux gras noirs mi-longs à la Bob Smith. Il enchaîne ce Zappa aux petits pieds, avec attaque à la Led Zep, refrain en un Queen maladroit, qu’est Over and Over and Over, que le public reprend en refrain (« Over and Over ») en levant le poing droit, puis Dead Leaves and the Dirty Ground du dernier déroutant album, Boarding House Reach, écrit chez lui sur son magnéto 4 pistes en posant sa mélodie chantée selon la méthode de M. Jackson, chez lui à Nashville puis 3 jours à chaque fois à NY & LA avec quatre musiciens virtuoses qui ne se connaissaient pas et Jack mélange le tout sur ordi (Pro Tools), et s’impose derechef : nous sommes cloués. La messe est dite. Il n’est pas là pour faire tapisserie, si on se réfère à son premier métier alors qu’il abandonna la calotte dont il a gardé le charisme. Le problème est que les nouveaux morceaux sont foutraques voire imbitables mais ne le clamait-on pas pour l’excellent Earthling de Bowie (1997) qui se renouvelait totalement après avoir inventé, dans le premier volet du diptyque, un nouveau personnage, Nathan Adler, dans 1. Outside (avec B. Eno pour travailler à un triptyque abandonné), grâce à la jungle alors dans le vent ? Au troisième morceau, White se retourne déjà pour passer une serviette noire sur la tronche ; il fera de même pour picoler … de l’eau en bouteille.
La laide et légendaire batteuse – faisant passer PJ Harvey pour une top modèle -, fine, aux bruns cheveux sales avec fleur orange sur le côté, qu’elle enlèvera quand elle reviendra, montre des plateforme-boots, sortes de ballerines noires sur d’énormes semelles compensées en liège – goût de chiotte, mais chacun les siens, peut-être fonctionnel pour jouer. Elle est juste devant moi puisque je suis dans le premier rang en fosse. En tout cas, elle envoie du bois grave. Ce n’est pas Max Roach mais elle respecte le jeu de Meg – qui savait autant jouer de la batterie que moi de la flûte de Pan -, la simplicité efficace, un côté brut. Elle apporte plus de subtilité sur d’autres morceaux, y’a pas de mal. Un côté Mitch Mitchell avec un nouveau Jimi, le duo fonctionne à merveille : sensation d’être à Monterey ou à l’île de … Wight. Elle se prendra un coussin Voisin vert qui désorientera un micro qui sera remis dans la bonne direction. La composition de la batterie est simple ; elle abuse des pads sur les indications de White – mauvaise voie.
Je ne suis pas cette direction Moonraker (Lewis Gilbert, 1979 un 007 raté où même l’excellent Lonsdale fait rire) des horribles années 80 comme ZZ Top (Afterburner, 1985) où Prince via Georges Clinton Parliament funkadelic avec une pincée d’Afrika Bambaataa ou de Bootsy Collins – alors que la basse, qui a peu de latitude mais arrive parfois à s’envoler – n’est pas Flea des Red Hot, Entwistle, Pastorius qui veut -, est somme toute assez classique rock – laissant songer au jazz fusion peu convainquant de Tutu de Miles (White en adopte la posture en jouant le chef d’orchestre d’un doigt de dieu, en se retournant ou en s’éclatant en egotrip sur la baffle Fender ; entre les morceaux, il laisse la guitare sur la Fender pour maintenir le larsen, un côté cracra qui est une marque d’authenticité dans une set list bien huilée, parfois enchaînée brut sans transition ; une fois, il n’oublie pas d’éteindre la pédale d’effet mais le souffle de la baffle reste), expérimentateur mais pas le plus heureux, Quincy et Herbie Hancock (Rockit dans Future Shock, 1983) en background. Il manque parfois une mélodie accrocheuse, un riff simple dans le dernier album peu convainquant mais à l’expérimentation intéressante ; les solos de guitares sont toujours présents.
Les images spatiales sont banales et aseptisées, sans recherche. Le coup de la batteuse qui joue aux fléchettes en noir et blanc sur la tête de Trump sur l’écran est facile mais le manque d’anti-Trump aurait déçu. Un extrait de comédie musicale non identifiée en noir et blanc avec un acteur qui ressemble au début à Max Linder. Une quasi solarisation des musiciens en trait pour trait réussie. Les images n’apportent pas grand-chose. Pas d’éclairage exceptionnel mais il aurait fallu du recul – n’étant pas ubiquitaire – pour en juger.
Sans transition
White conclut la première partie avec l’hymne des The Raconters, Steady as she goes. Le rappel replonge dans les The White Stripes avec I’m Slowly Turning Into You, le single, et néanmoins tube du dernier et troisième album solo de White, Connected by Love, au chant proche de l’esprit d’Otis Redding et à la mélodie à la U2, inspirée de John Lennon période Plastic Ono Band, puis le déjanté et psyché Ice Station Zebra pour finir en apothéose avec l’inévitable classique Seven National Army.
Public
Le public est plus calme que prévu, pas de pogo. Nous sautillons sur certains morceaux, les anciens surtout, où nous retrouvons nos petits en un rock renouvelé aux racines confirmées. Une dizaine de gens, mûrs puis plus jeunes, surnagent, portés par la foule, et échapperont aux agents de sécurité, bredouilles, qui se baissent sur leurs genoux comme des atlas ou des chiens limiers pour chasse ayant humé leur proie pour les récupérer et les virer comme ils le firent en masse en 2016 pour The Offspring. White tente de faire chanter le public mais n’y arrive pas, sauf sur le désormais classique riff de Seven nation army, car ces paroles défilent à rallonge (s’il est bavard, sa « poésie » n’atteint pas celle de Dylan dont le Nobel est toutefois abusif) ; il s’excuse de ne pas parler français. Le seul mot sera « Lyon » répété deux fois au début. Il dira de longues phrases en anglais que personne ne capte sauf les anglophones aguerris. Il a fait son taf sur 1h40 denses mais il n’est pas encore à l’aise pour dialoguer avec le public, ce n’est pas son propos. Il salue comme s’il était au théâtre, l’entrepreneur (à la tête de Third man Records, il produit, des rappeurs dernièrement tels que Black Milk, Insane Clown Posse ou Shirt, crée une usine de pressage de vinyles dans un quartier défavorisé de sa ville natale Detroit, envoie un disque sur platine dans l’espace grâce au Projet Icare, décore des battes de base ball, etc.) a l’esprit d’équipe. Il manquait tout de même Fell in Love with a Girl qu’il a pourtant joué en rappel au concert à l’Olympia puisque Jack n’a opté que pour trois lieux en France et 4 dates. Je mets mon sac à dos sur la tête pour éviter ces foutus coussins qui font mal, une tradition rock ‘n roll des Nuits de Fourvière à laquelle a dérogé Björk. Une fille me fait toc-toc pour me dire que je gênais en me protégeant ; je lui explique que le concert est fini. Les lumières s’allument ; les roadies, dont une femme, se réactivent. Le public de fosse pue la sueur, une infection.
Setlist :
Over and Over and Over
Dead Leaves and the Dirty Ground (The White Stripes)
Corporation
Why Walk a Dog ?
High Ball Stepper
I Think I Smell a Rat (The White Stripes)
Hotel Yorba (The White Stripes)
Hypocritical Kiss
Broken Boy Soldier (The Raconteurs)
What’s Done Is Done
Freedom at 21
I Cut Like a Buffalo (The Dead Weather)
Hello Operator (The White Stripes)
Ball and Biscuit (The White Stripes)
Get in the Mind Shaft
Respect Commander
That Black Bat Licorice
Just One Drink
We’re Going to Be Friends (The White Stripes)
You’ve Got Her in Your Pocket (The White Stripes)
Steady, as She Goes (The Raconteurs)
I’m Slowly Turning Into You (The White Stripes)
Connected by Love
Ice Station Zebra
Seven Nation Army (The White Stripes)
Photo : David James Swanson